Les attentats de Paris en 1995 : Plusieurs sources credibles affirment que le nouveau proces de Rachid Ramda pourrait faire tomber Sarkosy dans les jours et semaines qui viennent si celui-ci ne dedommage pas les victimes algeriennes du terrorisme francais et de ses GIAs. Rachid Ramda est a l'Algerie ce que Ali Megrahi est a la Libye dans l'affaire de Lockerbie, tous les elements materiels prouvent que les generaux Lamari, Tewfik de la DST-DRS n'ont pu agir qu'avec l'assistance, la couverture du gouvernement francais... Il s'avere aujourd'hui que Lamari, liquidé car essayant de negocier sa retraite en Amerique du Sud, au Paraguay, Tewfik et le larbin Ali Tounsi sont des harkis de la DST en Algerie...
Les attentats de Paris 1995 : ce qu'écrivaient en 2004 les auteurs de Françalgérie, crimes et mensonges d'États
Chapitre 23
Terreur sur l'Europe
En autorisant fin 1994 le président Zéroual à organiser une élection présidentielle l'année suivante, les généraux éradicateurs ont obtenu qu'il mette fin à ses initiatives dialoguistes et ils ont pu réactiver la « lutte antiterroriste ». Leur objectif : « Nettoyer le terrain » pour la présidentielle, s'assurer qu'aucun islamiste ni aucun démocrate crédible ne viendront remettre en cause leur pouvoir. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est l'accord de Rome. En s'engageant publiquement à respecter la démocratie, les représentants du FIS basés en Europe et aux États-Unis ont fait la preuve de leur pragmatisme et ils ont contribué à convaincre la communauté internationale qu'ils pouvaient légitimement participer à un processus de paix. Autre souci pour le « clan éradicateur », on l'a vu, les dirigeants du FIS se démarquent de plus en plus clairement du GIA et condamnent désormais systématiquement les attentats attribués à Djamel Zitouni (1).
En ce printemps 1995, l'opinion internationale risque donc de comprendre que sous la férule de ce dernier, le GIA n'est plus qu'une « organisation écran » du DRS. Pour les patrons des « services », il devient donc essentiel de neutraliser les représentants du parti d'Abassi Madani qui militent en Europe en faveur des accords de Rome et d'empêcher des pays comme la France de basculer en faveur du dialogue. À l'époque, trois pays sont particulièrement surveillés par le DRS : la Grande-Bretagne, d'où les militants du FIS développent une importante propagande contre le régime, la France, où vit encore le cheikh Abdelbaki Sahraoui, le très respecté cofondateur du FIS, et l'Allemagne, où est installé Rabah Kébir, porte-parole du mouvement.
Jusque-là cantonné au territoire algérien, le GIA de Djamel Zitouni va désormais être utilisé par le DRS pour éliminer des opposants en Europe et organiser des attentats de nature à inciter l'Occident à se radicaliser à nouveau contre l'islamisme.
Le GIA débarque à Londres
Depuis l'interruption du processus électoral, en janvier 1992, beaucoup d'opposants algériens sont réfugiés en Grande-Bretagne. À Londres, les hommes du DRS surveillent particulièrement des sympathisants islamistes comme Kamel Rebika ou Abdallah Messaï, qui distribuent en Angleterre le bulletin du FIS. Pour contrôler leurs activités, les services sont prêts à tout : « À chaque fois que des sympathisants à nous allaient chercher des papiers à l'ambassade, se souvient Messaï, les autorités leur demandaient de devenir des indicateurs de la Sécurité militaire en donnant des informations sur nous et nos activités. Un jour, ajoute l'ancien sympathisant du FIS en souriant, ils ont appelé l'épouse d'un de nos militants en lui disant : “La police va venir, il faut jeter tous vos carnets d'adresse à la poubelle, tout ce que vous avez, tous les documents qui contiennent des indications.” La pauvre, elle était un peu naïve, elle a pris peur, elle a tout jeté dans la poubelle de la rue. Le soir, quand son mari est revenu à la maison, il a cherché à récupérer les documents dans la poubelle (les éboueurs n'étaient pas encore passés), mais il n'a rien trouvé ! Les gens de l'ambassade étaient venus les récupérer (2)… »
À partir de 1994, les méthodes du DRS se professionnalisent. Sur ordre du général Toufik Médiène, de nouvelles équipes sont formées et envoyées en Europe : « On les appelait les “équipes d'investigation et d'intervention”, nous a expliqué l'ex-adjudant Abdelkader Tigha. Elles étaient spécialisées dans le recueil de renseignement, les filatures, les identifications et les photographies. » Se faisant parfois passer pour des employés d'Air Algérie, les agents du général Médiène interviennent en Belgique, en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne, avec des objectifs précis : « À Londres, raconte Tigha, le capitaine Abdelhak et cinq autres éléments sillonnaient chaque jour les mosquées de la capitale. Ils photographiaient les suspects et les suivaient partout. Il y avait des ordres du général Médiène pour liquider des opposants sur le sol européen dès que l'occasion se présenterait. »
Dans les mosquées de Londres, les hommes du capitaine Abdelhak croisent Abdallah Messaï, dont l'activité consiste à récolter de l'argent auprès des fidèles pour « aider les familles des moudjahidines », mais aussi à diffuser auprès de la communauté internationale les vrais communiqués islamistes en provenance d'Algérie : « On était parmi les seuls à distribuer au journal El-Hayat et au monde entier des bulletins réguliers informant des combats qui se déroulaient en Algérie, se souvient Messaï. Car il y avait des combats tous les jours, des morts tous les jours. Il ne faut pas oublier cela (3). On recevait les communiqués par fax et si on les croyait authentiques, on les distribuait. »
À partir de juillet 1994 et de l'assassinat des marins italiens (voir supra , chapitre 22), les groupes armés dont Messaï et ses compagnons distribuent la propagande commencent à se démarquer du GIA, qu'ils accusent d'être infiltré par le DRS : « À l'époque, estime Messaï, El-Ansar , le “bulletin du GIA” disait qu'il fallait commettre des attentats à Paris, massacrer les impies. Nous, on était contre ce genre d'actions dès le départ. On pensait que les membres de ces GIA n'étaient pas de vrais moudjahidines mais qu'ils travaillaient en fait pour la Sécurité militaire. Beaucoup étaient probablement des abrutis qui travaillaient pour le régime sans même s'en rendre compte. »
En 1995, estimant qu'il devient évident que le GIA est infiltré par les services, Messaï et ses compagnons commencent à rassembler les communiqués dans lesquels leurs groupes s'en sont démarqués (4). Devenus gênants, ils sont bientôt contactés par un étrange Algérien : Réda Hassaine. « Ce monsieur est venu nous voir pour tenter de discréditer l'un des groupes dont nous diffusions les communiqués. C'était un groupe qui avait toujours soutenu l'Armée islamique du salut [bras armé du FIS], qui s'était toujours opposé aux assassinats d'étrangers et d'enfants. Hassaine prétendait que ce groupe collaborait en fait avec les services algériens, comme pour tenter de le discréditer à nos yeux. En fait, nous étions certains que le groupe en question ne collaborait pas avec les services. On en a donc conclu que celui qui travaillait pour les services, c'était Hassaine lui-même. Il l'a d'ailleurs reconnu par la suite (5). Il était là pour introduire la pagaille dans les milieux islamistes de Londres, pour semer la confusion et brouiller les pistes… » Prudents, Messaï et ses compagnons évitent de tomber dans le piège tendu par Réda Hassaine : « Si on avait cru ce qu'il nous racontait, estime Kamel Rebika, autre militant du FIS, seuls les faux communiqués du GIA auraient été diffusés. »
À une période qu'ils situent vers 1994-1995, Messaï et Rebika apprennent par des sympathisants d'Alger que le DRS vient d'envoyer à Londres plusieurs dizaines d'agents. Leur mission : agiter l'épouvantail du GIA en Europe et empêcher les représentants du FIS d'en révéler la vraie nature à l'opinion internationale : « On nous a dit que c'était pour nous faire taire, pour nous empêcher de nous attaquer au GIA, se souvient Abdallah Messaï. On a commencé à avoir peur de se faire assassiner, on s'est mis à faire attention. Quelques semaines plus tard, devant la mosquée de Regent's Park, de jeunes Algériens que nous ne connaissions pas se sont mis à distribuer El-Ansar en criant des slogans comme : “Vive le GIA ! Le FIS est fini ! Les élections de 1991 étaient illégales devant l'islam ! Pas de dialogue !” Ils critiquaient le FIS, faisaient pression sur nous, nous insultaient, nous menaçaient. Certains d'entre eux soutenaient le GIA alors qu'ils n'étaient même pas Algériens. »
Au fil des jours, les mystérieux agitateurs débarqués d'Alger se font de plus en plus provocants, allant jusqu'à distribuer devant la mosquée de Regent's Park des bulletins ordonnant de tuer tous les juifs et tous les chrétiens : « Non seulement c'était totalement contraire à l'islam, se souvient Messaï, mais surtout, c'était de nature à nous discréditer vis-à-vis de la police. Les Anglais ne pouvaient pas accepter que de tels tracts soient distribués sur la place publique. Le plus étonnant, c'est que ces jeunes se réclamant du GIA se déplaçaient librement. C'était extraordinaire. Nous, on n'avait aucune possibilité d'aller en Algérie. On avait peur. Eux, ils se déplaçaient librement, allaient et venaient et disaient publiquement à Londres : “Non au dialogue, il faut tuer tout le monde”. »
Pour renforcer l'efficacité de leurs opérations de guerre psychologique, les généraux donnent des consignes très strictes à leurs attachés militaires en poste à l'étranger : « Quand je recevais des émissaires d'Alger, se souvient l'ex-colonel Samraoui, alors en poste en Allemagne, ils nous demandaient de relayer un discours selon lequel le régime algérien était un rempart susceptible d'empêcher l'islamisme d'atteindre l'Europe. Mais en fait, le contexte était difficile pour les généraux éradicateurs. Nous n'avions pas vraiment le soutien de la communauté internationale (6). »
Pour populariser son combat et discréditer plus encore les islamistes, le « clan Belkheir » a besoin de l'aide de la « société civile ». En avril 1995, l'une des plus célèbres opposantes algériennes à l'islamisme, Khalida Messaoudi, lui apporte un soutien déterminant en publiant avec une journaliste du Nouvel Observateur , Élisabeth Schemla, un livre d'entretien intitulé Une Algérienne debout . Brûlot anti-FIS surfant sur la peur de l'islam, l'ouvrage devient vite un best-seller. C'est un avertissement aux dirigeants politiques français favorables à un compromis avec les islamistes.
Le « cri » de Khalida Messaoudi
Professeur de mathématiques, Khalida Messaoudi est originaire de Sidi Ali-Moussa, à une vingtaine de kilomètres de Tizi-Ouzou. Femme courageuse, elle mène dans les années 1990, avec une petite minorité d'intellectuels francophones ayant tendance à monopoliser la parole algérienne dans les médias français, une croisade anti-islamiste à la tonalité très « éradicatrice » (7). Élevée dans une famille de marabouts prônant un islam traditionnel, celui des zaouïas, elle a grandi avec une mère qui n'avait pas le droit de sortir de chez elle, et qui ne l'a jamais fait en trente ans.
Dès les premières pages de son livre, Khalida Messaoudi livre quelques clés laissant entrevoir combien le sort réservé à sa mère a déterminé son propre engagement politique : « Les familles maraboutiques, explique-t-elle, sont les plus atroces pour les femmes. Car ces castes ne tolèrent pas qu'elles travaillent à l'intérieur de la maison, sauf pour cuisiner. Le reste — tout le reste — aller chercher de l'eau à la fontaine ou du bois, faire les commissions, laver —, des femmes non marabouts le font pour elles, si bien que ma mère ne mettait jamais le nez dehors. […] Ce qu'elle a accepté pour elle, intériorisé, elle savait que j'étais en mesure, moi, de le refuser et c'était sa revanche sur le destin (8) ! » En Kabylie, le droit coutumier relève pour Khalida Messaoudi de ce qu'elle appelle le « fondamentalisme berbère », qu'elle juge « encore plus obscurantiste que le Coran », notamment en ce qui concerne l'héritage.
À la fin des années 1980, c'est en luttant contre le code de la famille, un texte adopté par le pouvoir à partir d'une vision particulièrement rétrograde de l'islam (voir supra , chapitre 3), que Khalida Messaoudi se fait connaître. En 1992, considérant que l'armée est finalement le meilleur rempart contre le « totalitarisme islamiste », elle cautionne l'interruption du processus électoral et devient le symbole des féministes francophones les plus éradicatrices. Car si Khalida Messaoudi reconnaît dans son livre que, par certains aspects, le FIS a libéré les femmes (en leur permettant de se marier sans avoir à solliciter le consentement des familles, en supprimant l'obligation de la dot, progrès considérable « dans une société de jeunes chômeurs sans le sou », mais aussi en leur accordant une « parole politique que le FLN ne leur a jamais accordée et qui, sous sa forme démocratique, est trop difficile à conquérir »), elle voue aux islamistes, qu'elle qualifie systématiquement d'« intégristes », une haine qui semble inextinguible. Au nom de cette haine, elle va fermer les yeux sur la généralisation de la torture, sur l'hyperviolence de la répression et sur les crimes du haut commandement militaire (alors qu'elle le pense impliqué dans l'assassinat du président Boudiaf) et accepter de cautionner le régime en siégeant jusqu'en janvier 1994 au Conseil consultatif national.
En avril 1995, alors que les accords de Rome viennent d'être signés, son livre justifie de facto la logique purement éradicatrice des généraux. Pour elle, interrompre les élections était un « devoir patriotique », les assassinats d'intellectuels sont l'œuvre exclusive des islamistes qui ne pensent qu'à « tuer l'intelligence, la création, l'alternative républicaine, la vie » et le soutien du président François Mitterrand aux accords de Rome est un « cadeau empoisonné ». « En fait, résumait en 1995 Rémy Leveau dans une allusion à Khalida Messaoudi et à ses amis éradicateurs, le pouvoir militaire s'est constamment servi de ces intellectuels pour donner, en Algérie comme à l'extérieur, un visage présentable à son action répressive, notamment pour justifier sa politique antiterroriste (9). »
Le livre de Khalida Messaoudi s'achève d'ailleurs sur un message en forme d'avertissement à la France et aux hommes politiques comme Alain Juppé, François Mitterrand, François Léotard ou Valéry Giscard d'Estaing qui exprimèrent le souhait qu'un compromis politique puisse mettre fin à la crise algérienne : « L'Amérique, dont les intérêts géostratégiques et économiques font depuis longtemps l'allié des États islamiques, s'accommoderait parfaitement d'une victoire des intégristes. Il ne faudrait pas que, par surenchère pour défendre son propre leadership en Algérie, la France verse à son tour dans la compromission avec les islamistes. Je me permets de rappeler que cette mouvance a déjà clairement choisi Washington. Je ne suis pas pour autant en train de dire que Paris doit continuer à soutenir le régime algérien. Je m'étonne au contraire que la France, républicaine et laïque, tarde à assumer et à soutenir ses alliés naturels : les démocrates qui résistent en Algérie et qui refusent toute alliance avec le “fascislamisme” (10). »
Contre la vérité, la torture
Si à l'époque, comme l'écrit Khalida Messaoudi, une partie de la classe politique française « tarde à soutenir » ces « démocrates » qui disent ne pas soutenir les généraux mais seulement leur option « éradicatrice », c'est notamment parce que, en France, des voix d'horizons politiques différents s'élèvent de plus en plus pour que Paris prenne ses distances à l'égard de la dérive sanguinaire du pouvoir. Fin février 1995, Bruno Étienne, professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et spécialiste internationalement reconnu du monde arabo-musulman, publie ainsi dans Libération une tribune qui énonce crûment quelques vérités. Alors qu'il est pied-noir et qu'il a lui-même contribué à la formation de la plupart des généraux algériens, l'universitaire critique les éradicateurs et la place démesurée qui leur est faite dans les médias français. Les qualifiant de « commandos médiatiques », il accuse les chaînes de télévision françaises de les « mettre en vedette » et de « surfer sur la peur de l'islam » pour des raisons d'audimat. Dans une ultime charge visant notamment les dirigeants du RCD de Saïd Sadi, le chercheur d'Aix-en-Provence conclut que « les Français n'ont pas encore admis que l'Algérie indépendante était arabe et musulmane et que les laïcs qui causent à la télé ne représentent personne (11) ».
En mars, les Cahiers de l'Orient publient « La grande peur bleue », un article particulièrement lucide des journalistes Rabah Attaf et Fausto Giudice sur la dérive répressive du haut commandement militaire algérien et sur l'aveuglement des médias français à ce sujet (12).
Le 27 avril 1995 (le jour même où, en Algérie, une cinquantaine de cadavres mutilés et décapités sont découverts dans la région de Jijel, à la suite de rafles des forces de sécurité (13), à deux semaines du second tour de l'élection présidentielle qui va voir triompher Jacques Chirac, des intellectuels français choqués par le fait que la France a vendu des hélicoptères au régime algérien emboîtent le pas à Bruno Étienne : ils lancent un « appel pour la paix et la démocratie en Algérie » et demandent que le gouvernement français « suspende toute aide militaire au pouvoir algérien ». Début mai 1995, enfin, le journaliste Éric Laurent signe dans L'Esprit libre , une nouvelle revue libérale, un article radical contre le « soutien aveugle » que la France apporte à la « junte militaire algérienne ». Proposant de « couper les ponts » avec le régime, l'auteur écrit notamment : « L'État français, libéral paraît-il, acquiesce non seulement à la ruine économique de son ancienne colonie, mais à la pire des prévarications. D'un point de vue froid et cynique, le jeu en vaut-il la chandelle ? Même pas. C'est à peine si nos industriels ne perdent pas d'argent dans ces affaires honteuses, tandis que notre diplomatie secrète se fait […] totalement ridiculiser. »
Et l'auteur de conclure : « Notre soutien aveugle à la dictature, même modéré par quelques timides protestations verbales, n'a eu que des effets négatifs. Adopter une autre politique, même à très haut risque, à condition qu'elle soit claire et partagée par tous les services concernés, ne pourrait être pire (14). » Véritable appel à lâcher le régime des généraux, cet article aurait particulièrement marqué Alain Juppé, à quelques jours de sa nomination à Matignon.
Même si toutes ces voix restent très minoritaires dans le paysage médiatique français, elles inquiètent au plus haut point les généraux « janviéristes ». En témoigne en cette période un épisode obscur de la « sale guerre », aussi atroce que tant d'autres, mais particulièrement significatif. Le 6 avril 1995, un certain Mohamed Benmerakchi, chauffeur de taxi, est arrêté à 2 heures du matin à son domicile, à Alger, par des policiers cagoulés et transféré au centre de Châteauneuf.
Son crime : il avait été accidentellement balayé par les caméras de la BBC pour un documentaire télévisé réalisé par le journaliste britannique Phil Rees sur la tragédie algérienne, rediffusé le 17 décembre 1994 par Canal Plus. Le terrorisme d'État algérien y était notamment dénoncé par le docteur Salah-Eddine Sidhoum, chirurgien orthopédiste et militant des droits de l'homme, que Benmerakchi aidait modestement, en lui servant de chauffeur. Trois mois plus tôt, le 5 septembre, le docteur Sidhoum avait déjà adressé une lettre ouverte au président Zéroual, pour dénoncer cinquante-trois cas concrets de tortures et d'exécutions sommaires, ce qui lui avait valu d'être inculpé pour « soutien aux terroristes ». Le lendemain même de la diffusion de ce reportage sur la chaîne française, le 18 décembre, trois hommes d'un escadron de la mort du DRS débarquaient à l'aube au domicile du docteur Sidhoum. Il n'était pas chez lui. Il n'y reviendra plus, et plongera pour plusieurs années dans la clandestinité (15).
Mais son chauffeur, Mohamed Benmerakchi, qui apparaissait dans le documentaire, est donc arrêté quatre mois plus tard : « Ils étaient tous cagoulés. Certains portaient des combinaisons noires, d'autres étaient en civil. […] L'un d'eux, le plus calme, me lança : “Alors, Canal Plus ? On va s'occuper de toi !” Je compris alors très vite qu'il s'agissait de mon apparition dans ce documentaire (16). » Emmené au commissariat de Chateauneuf, Mohamed Benmerakchi est violemment torturé à l'électricité pendant quarante jours : « C'était horrible. Lors des décharges, je sentais comme si mes yeux allaient sortir de leurs orbites. Au même moment, un autre tortionnaire jetait de l'eau sale et froide sur mon corps. Je sursautais malgré mes attaches. Je perdais encore une fois connaissance. » Ignorant où se cache le docteur Sidhoum, Benmerakchi est finalement relâché dans un état lamentable.
Pour les journalistes de télévision étrangers désireux d'enquêter en Algérie, cette affaire est un avertissement sans ambiguïté : comment recueillir des témoignages susceptibles de mettre en cause les autorités quand les témoins risquent d'être torturés après la diffusion ? C'est ce qui explique que, depuis 1992, à de rares exceptions près, seuls les Algériens exilés à l'étranger peuvent s'exprimer plus ou moins librement sur la sale guerre qui ravage leur pays (mais la plupart refusent de le faire, par crainte — justifiée — de représailles contre leur famille restée en Algérie). Les autres, tous les autres, ne peuvent le plus souvent accorder aux télévisions étrangères qui les rencontrent, en présence d'escortes militaires, que des témoignages biaisés.
Un « dialoguiste » à Matignon
À la fin du mois d'avril 1995, il apparaît de plus en plus clairement que, contrairement aux pronostics initiaux, Charles Pasqua et Édouard Balladur, les candidats favoris d'Alger pour la présidentielle française, vont être battus. Entre les deux tours, Rabah Kébir appelle le « futur président de la République française » à « réviser sa position sur la crise algérienne ». Le 10 mai 1995, c'est Jacques Chirac qui est élu président. De Washington, Anouar Haddam, président de la délégation parlementaire du FIS à l'étranger, l'invite à apporter un « soutien actif à la plate-forme de Rome ».
Avec la nomination d'Alain Juppé à Matignon, les « dialoguistes » acquièrent la conviction que la France va enfin s'engager plus fermement en faveur d'un processus de paix en Algérie, perspective qui inquiète les éradicateurs : « Le régime sait pertinemment que la France est le baromètre de l'opinion mondiale sur l'Algérie, explique William Byrd, banquier américain spécialiste de l'Algérie. Les Algériens mettent donc une énergie incroyable à comprendre le système français, à financer ses partis politiques, à détenir des informations sur des hommes politiques qui craignent toujours le scandale, contrairement aux dirigeants algériens qui, eux, sont à la tête d'une dictature. Le dominant n'est pas toujours celui qu'on croit : les Algériens peuvent menacer, ils font peur (17). »
Pour empêcher la France de changer de politique en pleine préparation de l'élection présidentielle algérienne et à quelques semaines d'échéances économiques fondamentales pour Alger (18), le DRS va se servir de la couverture du GIA pour organiser des attentats terroristes en Europe. Neuf ans après les faits, les témoignages de plusieurs anciens officiers du DRS permettent de comprendre le scénario diabolique qui s'est mis en place à l'époque : « La coopération antiterroriste avec les Français ne fonctionnait pas, révèle aujourd'hui l'ex-adjudant Abdelkader Tigha. Début 1995, il y avait bien eu quelques réunions à Lyon en présence de mon frère, haut responsable de la police judiciaire à Blida, et du colonel Achour Boukachabia, chef de la SDCI, la contre-intelligence, mais les infos qu'on avait, qui étaient issues de simples interrogatoires, ne pesaient pas lourd. Du coup, les services français ne voulaient pas nous aider. Ils nous ont dit que nos infos, c'était “de la salade”. Ils expliquaient qu'ils devaient tenir compte de l'opinion publique, des partis politiques, de la justice, qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, arrêter n'importe qui. Les Algériens sont revenus fâchés, déçus. Smaïl Lamari [chef de la DCE et numéro deux du DRS] cherchait un moyen d'inciter les politiques français à nous aider. On avait besoin de renseignement, d'armement, de moyens techniques, de détecteurs de bombes… C'est là qu'on a décidé d'exporter quelques actions sur le sol français (19). »
« À l'origine de ce plan, il y avait Smaïl Lamari et Ali Benguedda, le responsable des services opérationnels de la DCE », précise le capitaine Ouguenoune, à l'époque officier de la DCSA à l'ambassade d'Algérie à Paris. Après la nomination d'Alain Juppé à Matignon, le plan concocté par les services opérationnels de la DCE se précise : il s'agit, d'une part, d'éliminer directement certains hauts dirigeants du FIS réfugiés en Europe et, d'autre part, de manipuler de jeunes Maghrébins un peu perdus pour les inciter à commettre des attentats en France. Dans les deux cas, c'est Djamel Zitouni, « émir national » du GIA, qui va servir de couverture aux opérations de guerre psychologique menées en Europe par le DRS.
À la fin du mois de mars 1995, une fatwa signée par le chef du GIA est publiée dans El-Ansar , ordonnant aux représentants du FIS à l'étranger de cesser leurs activités (20). Le 10 mai, comme pour marquer les esprits le jour même de l'accession de Jacques Chirac à la présidence de la République, le GIA annonce qu'il revendique l'assassinat de coopérants français tués cinq jours auparavant en Algérie (à Ghardaïa), des assassinats « déplorés » par le FIS. Quarante-huit heures plus tard, au moment même où les agents du DRS engagent au sein du GIA une purge décisive contre les islamistes qu'ils ne contrôlent pas (voir chapitre précédent), un nouveau communiqué signé « Zitouni » menace de mort plusieurs représentants du FIS en exil s'ils « ne s'abstiennent pas dans les six mois de parler au nom de la lutte et de rencontrer des officiels des pays hôtes (21) » : « Cette fameuse liste avait été faite à Ben-Aknoun, dans les locaux du DRS, nous a révélé l'ex-colonel B. Ali. Il fallait éliminer les “intellectuels” du FIS, tous ceux qui pensaient et qui réfléchissaient (22). »
Sur la liste du DRS, on trouve des responsables islamistes favorables au dialogue et dont beaucoup ont pris — plus ou moins tôt — leurs distances à l'égard de la violence du GIA. C'est le cas du vieux cheikh Abdelbaki Sahraoui, un modéré du FIS qui dirige la mosquée de la rue Myrha, à Paris ; de Rabah Kébir, le président de l'Instance exécutive du FIS à l'étranger ; de Anouar Haddam, président de la délégation parlementaire du FIS en exil ; de Ahmed Zaoui, dirigeant du FIS qui a échappé à des rafles menées à Bruxelles au printemps ; d'Abdellah Anas, d'Abdelkader Sahraoui, des enfants d'Abassi Madani, etc. Le 15 juin, un nouveau communiqué signé « Zitouni » annonce « exclure de ses rangs » Abassi Madani et Ali Benhadj, comme s'ils étaient membres du GIA (23)…
À la mi-mai 1995, le nouveau ministre français de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, est informé par ses services de renseignement qu'un certain Abdallah Kronfel, alias Yahia Rihane, doit prendre contact à Paris avec un de ses homologues islamistes (24). Soupçonné d'avoir été mêlé au détournement de l'Airbus d'Air France en décembre 1994, Kronfel a la réputation d'être un dangereux terroriste. Et très curieusement, le 1 er juillet, juste après l'échec d'une nouvelle tentative de dialogue entre le président Zéroual et les dirigeants du FIS, un journaliste du quotidien pro-gouvernemental algérien La Tribune , réputé proche des services de sécurité, annonce qu'« un commando venu de Bosnie aurait eu pour mission de perpétrer des attentats dans la capitale française et aurait reçu comme instruction d'éliminer des islamistes condamnés à mort par le GIA comme Abdelbaki Sahraoui et Moussa Kraouche (25) ».
Aussitôt, ces mystérieux « terroristes » annoncés par La Tribune passent à l'action. À Paris, plusieurs personnalités algériennes exilées, connues pour avoir pris leurs distances à l'égard du régime, reçoivent de mystérieuses menaces de mort. C'est notamment le cas de l'historien Mohammed Harbi, et aussi du réformateur Ghazi Hidouci, ancien ministre de l'Économie du gouvernement Hamrouche : « Un jour, deux individus habillés comme des islamistes sont venus déposer dans ma boîte aux lettres des menaces de mort et un petit cercueil, raconte Hidouci. Plusieurs services français sont alors venus m'interroger sur l'affaire. Je me souviens notamment d'un représentant du ministère français de la Défense. Il est venu plusieurs fois, et il a fini par nous révéler qu'il travaillait pour la DGSE. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de ces menaces de mort du GIA, il a souri. Pour lui, il était clair que mes mystérieux visiteurs travaillaient en réalité pour la Sécurité militaire algérienne (26)… »
Et en cet été 1995, les mystérieux terroristes arrivés d'Alger ne se contentent pas de diffuser des menaces de mort…
L'assassinat du cheikh Sahraoui
Le 11 juillet 1995, vers 18 h 20, deux hommes armés pénètrent dans la mosquée de la rue Myrha, dans le 18 e arrondissement de Paris. Ce jour-là, les policiers des Renseignements généraux qui surveillent habituellement les abords de ce lieu de culte sensible ne sont pas présents (27) : « Les deux hommes ont fait leur prière, puis l'un d'eux a demandé à voir le cheikh [Abdelbaki Sahraoui] en tête-à-tête dans un petit bureau, raconte Brahim Younsi, alors proche collaborateur du cheikh. Après quelques minutes de discussion, il a sorti un fusil de son sac et l'a tué à bout portant. Quand il a tenté de quitter les lieux, un proche de l'imam l'a ceinturé, puis a tenté de fermer la sortie de la mosquée. C'est là que le complice du tueur a tiré à son tour, abattant le fidèle (28). » Après l'assassinat, les deux tueurs (décrits par des témoins comme « Arabes, sans aucun doute Algériens et âgés de trente-cinq à quarante ans ») courent quelques centaines de mètres et braquent un véhicule qui sera retrouvé rue du Nord, dans le XVIII e arrondissement de Paris (29). Entendue par la police, la conductrice du véhicule reçoit l'ordre de ne pas communiquer avec la presse (30).
Vieux militant nationaliste, cofondateur du FIS, Abdelbaki Sahraoui, âgé de quatre-vingt-cinq ans, était un islamiste modéré. Depuis deux ans, il était président honorifique de l'Instance exécutive du FIS à l'étranger. Partisan d'un dialogue avec le président Zéroual, il entretenait des contacts réguliers avec Abassi Madani, mais aussi avec les autorités françaises, qui appréciaient sa modération et qui le consultaient même en cas de crise grave, comme lors du détournement de l'Airbus d'Air France en décembre 1994. Opposé depuis toujours au transfert du conflit algérien sur le territoire français, le cheikh Sahraoui acceptait volontiers les invitations de la télévision française, comme en 1994, quand il participa à un débat animé par Pierre Thivolet sur la chaîne française Arte avec Omar Belhouchet, le patron d' El-Watan .
Le vieux cheikh était devenu embarrassant pour les éradicateurs. Dans les mois précédant son assassinat, il avait multiplié les déclarations montrant qu'il avait compris la vraie nature du GIA : le 9 mai 1994, par exemple, suite à l'assassinat dans la Casbah de deux religieux français, Henri Vergès et Paul-Hélène Saint-Raymond (crime qualifié de « contraire à la loi islamique » par Rabah Kébir), il avait estimé dans une lettre que les auteurs du meurtre « appartiennent sans doute aux tenants de l'éradication, hostiles à toute perspective de règlement politique du conflit dans lequel on cherche délibérément à entraîner la France (31) ». Quelques mois plus tard, en août, réagissant au regroupement illégal de vingt-six islamistes algériens dans une caserne de Folembray par le ministère français de l'Intérieur (voir supra , chapitre 20), le vieux cheikh contredit publiquement Charles Pasqua et les éradicateurs d'Alger : estimant que les assignés à résidence n'ont commis aucun délit, il affirme qu'il ne s'agit pas de terroristes et qu'« aucune menace terroriste ne pèse sur la France (32) ». Le 30 octobre 1994, il condamne l'assassinat de deux religieuses espagnoles à Bab-el-Oued, Esther Paniaqua et Caridad Maria. Fin décembre, après le détournement de l'Airbus d'Air France, il se démarque une nouvelle fois du GIA de Djamel Zitouni et appelle au calme, ce qui lui vaut les critiques des extrémistes (33).
Bref, depuis plusieurs mois, Sahraoui est la preuve vivante qu'il existe des dirigeants islamistes modérés avec lesquels il est possible de dialoguer. Il gêne donc la stratégie de diabolisation du FIS adoptée par Charles Pasqua et les éradicateurs d'Alger. Quant à ses déclarations laissant entendre que le GIA est probablement manipulé par le DRS, elles sont encore plus dérangeantes. Selon Hubert Coudurier, auteur d'un ouvrage remarqué sur la diplomatie secrète de Jacques Chirac, Sahraoui était en « étroite relation » avec certains services français qu'il risquait d'éclairer sur l'« origine des attentats à venir (34) » (d'après certains témoignages, le cheikh Sahraoui leur servait même d'intermédiaire dans le cadre d'un dialogue avec le mouvement islamiste (35)).
Le vieil imam était-il sur le point de révéler aux autorités françaises l'identité des véritables commanditaires du GIA ? Rue Myrha, en tout cas, ses fidèles sont persuadés qu'il a été tué par des agents du DRS : « Vous ne trouverez pas un seul fidèle qui pense que le cheikh a été tué par des islamistes, déclare au Monde le principal collaborateur de l'imam assassiné. Ils n'auraient pas touché au cheikh. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui le trouvaient trop modéré, le respectaient. Quant aux groupes d'ultras, ils sont de toute façon noyautés par la Sécurité militaire. Les services sont capables de tout. En France, ils sont chez eux. Rappelez-vous Mécili [voir supra , chapitre 4] : ils avaient le meurtrier, mais comme c'était un agent algérien, Pasqua l'a fait expulser vers l'Algérie, autrement dit, il l'a relâché (36). »
Et les proches de l'imam ne sont pas les seuls à soupçonner le DRS d'avoir commandité son assassinat. Le lendemain du crime, un policier français spécialiste des mouvements islamistes confie lui aussi ses doutes à une journaliste de Libération : « Soit on a affaire à des gens d'un réseau inconnu sur notre sol, soit à des hommes venus d'un pays étranger et déjà repartis ou sur le point de le faire (37). »
Revendiqué par un communiqué signé « Zitouni » et salué depuis Londres par Abou Hamza, l'un des responsables du bulletin El-Ansar , l'assassinat du cheikh Sahraoui va être perçu par de nombreux islamistes algériens comme une opération ayant bénéficié de l'aval de certains services secrets européens. En 1997, lors d'un tournage à Londres, un fidèle de la mosquée de Finsbury Park laisse éclater sa colère devant notre caméra : « L'Europe est d'accord avec ce type d'attentat, elle les couvre ! La France dit qu'elle ne sait pas qui a tué l'imam Sahraoui à Paris. Or Abou Hamza [animateur du bulletin El-Ansar et dirigeant de la mosquée londonienne de Finsbury Park] a déclaré ici à Londres : “C'est nous qui l'avons tué parce que c'est un démocrate.” Pourquoi la DST ne vient-elle pas chercher Abou Hamza ? Les Anglais non plus ne font rien : il passe son temps à faire des déclarations provocatrices ici à Londres, et ils ne lui disent rien (38). »
Dans son livre, l'ex-colonel Samraoui propose une explication à cette étrange impunité : selon lui, Abou Hamza était dès cette époque manipulé par son homologue de Londres, le colonel Ali Derdouri, chef d'antenne du DRS dans la capitale britannique (39). Une semaine après l'assassinat du vieux cheikh, le 17 juillet, le quotidien algérien La Tribune publie un nouvel article. Cette fois, le journaliste prétend révéler le nom du commanditaire de l'assassinat du cheikh Sahraoui : il s'agirait d'un certain Abdessabour, qui pourrait être Abdelkrim Dénèche, un opposant islamiste algérien réfugié en Suède dont le nom a déjà été communiqué aux autorités françaises par le DRS (40).
Selon cette version, le FIS serait responsable de l'assassinat de… l'un de ses fondateurs ! Pour les enquêteurs français, le dirigeant cité par La Tribune « existe », mais il ne s'est « jamais manifesté en France » et « rien ne permet de dire qu'il est impliqué dans le double crime de la rue Myrha (41) ». Les deux meurtres de la rue Myrha ne seront jamais élucidés.
Quelques semaines plus tard, alors que Paris est secoué par l'une des plus graves campagnes d'attentats jamais organisée en France, c'est au tour de Rabah Kébir, un autre dirigeant islamiste important qui figurait sur la liste de Djamel Zitouni, d'être visé par un projet d'assassinat. Mais cette fois, l'ex-colonel Samraoui, chargé d'organiser l'attentat, décide de s'y opposer et de déserter.
L'affaire Rabah Kébir
Arrivé à Bonn quelques mois après le coup d'État de 1992, Rabah Kébir, le représentant de l'Instance exécutive du FIS à l'étranger, est le type même de l'opposant embarrassant. Tout comme le cheikh Sahraoui, il condamne régulièrement les assassinats d'étrangers imputés au GIA et va à l'encontre de l'image sanguinaire que les éradicateurs d'Alger voudraient donner du FIS. Discrètement mais inlassablement, Kébir milite pour que la communauté internationale comprenne qu'un compromis politique est possible en Algérie et qu'elle cesse de soutenir inconditionnellement le régime. En novembre 1994, la participation de son parti à la première rencontre de Rome démontre que contrairement à ce qu'affirment les généraux éradicateurs, le FIS est capable de s'engager dans un processus de paix.
À la fin de l'année 1994, l'ex-colonel Samraoui, alors attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Bonn, reçoit l'ordre de surveiller le représentant du FIS de très près : « On a mis en place un dispositif pour recueillir un maximum d'informations sur Rabah Kébir (habitation, entourage, fréquentations…) et préparer des attentats contre lui et Abdelkader Sahraoui (un de ses adjoints, à ne pas confondre avec le cheikh Abdelbaki Sahraoui assassiné à Paris le 11 juillet 1995). Pour Rabah Kébir, on a fait venir progressivement sept ou huit officiers pour préparer l'opération. Puis, on a fait venir le général Bendjelti, avec le chef de cabinet du général Smaïn [Smaïl Lamari, patron de la DCE]. Moi, je ne pensais pas qu'ils voulaient aller jusqu'à l'assassinat. On parlait d'infliger un “coup” aux islamistes. Le mot d'exécution n'avait pas été prononcé. Puis, en septembre 1995, Smaïn est venu une deuxième fois avec le colonel Ali Benguedda, dit “petit Smaïn”, et le colonel Rachid Laâlali, dit “Attafi”, mes prédécesseurs au poste d'attaché militaire à Bonn qui connaissaient parfaitement la ville. Pendant quarante-huit heures, Smaïn a consulté les dossiers et il m'a dit : “Si tout est prêt, on peut passer à l'étape finale : l'exécution de Rabah Kébir et de Abdelkader Sahraoui” (42). »
Dans son livre, l'ex-colonel Samraoui révèle que le général Smaïn avait été jusqu'à réfléchir à la façon dont l'assassinat devrait être présenté à l'opinion publique : « Il hésitait entre un “règlement de comptes” entre factions rivales du FIS […] (il était prêt à diffuser des tracts et des faux communiqués en ce sens, dans lesquels le GIA revendiquerait ces assassinats) et un crime “sans mobile” (qui compliquerait selon lui la tâche des enquêteurs). Il voulait me charger de cette mission : “Tu t'occupes de cette affaire, tu as carte blanche. Salah [le commandant Salah Kermad] se chargera de mettre à ta disposition deux Yougoslaves si tu choisis la seconde solution, sinon j'ai un Palestinien qui peut s'acquitter de la besogne” (43). »
Confronté à une mission qui lui semble aller trop loin, l'ex-colonel Samraoui exprime alors ses réticences au patron de la DCE, mais celui-ci insiste : « C'est tout réfléchi, il faut clouer le bec à ces salauds qui mettent l'Algérie à feu et à sang, et nous empêchent d'obtenir le soutien international. Le spectre de l'intégrisme et la formule de l'instauration d'une république islamique en Algérie déstabilisant le Maghreb et constituant une base pour d'éventuelles attaques contre l'Occident ne semblent pas convaincre nos partenaires européens. Il faut un événement fort pour secouer leur conscience, comme ce fut le cas avec les Français (44). » Le général Smaïn Lamari faisait évidemment référence à la campagne d'attentats dans le RER parisien qui avait terrorisé les Français dans les semaines précédentes…
En septembre 1995, alors que l'opération consistant à assassiner Rabah Kébir entre dans sa phase finale, Samraoui décide de s'y opposer : « J'ai mis Smaïn en garde contre ce genre d'opérations, j'ai attiré son attention sur les conséquences qu'elle pourrait avoir. Je lui ai dit : “Ici, vous êtes en Allemagne, pas en France. Là-bas, vous avez des amis : Yves Bonnet, Jean-Charles Marchiani, peut-être Charles Pasqua, vous pouvez être protégés. Mais ici, vous n'avez personne.” Il a vu que je n'étais pas chaud. Et puis je savais qu'en cas d'échec, je servirai le fusible. Après quelques minutes de silence, le général Smaïn, le regard foudroyant, dit d'un ton grave : “Je prends acte de ton refus, mais je ne sais pas s'il est motivé par une question de principe ou par incapacité à conduire cette mission.” Devant mon refus d'organiser l'assassinat de Rabah Kébir, ils ont repris l'avion. À partir de là, je savais qu'ils ne me rateraient pas (45). »
Le 12 février 1996, après avoir sollicité en vain une entrevue avec le président Liamine Zéroual, l'ex-colonel Samraoui déserte, puis obtient l'asile politique en Allemagne. En juillet 2002, sollicité comme témoin lors du procès Nezzar à Paris, il révélera l'« affaire Rabah Kébir » à la justice française (46). Mais en cet été 1995, l'affaire Kébir est encore confidentielle. Ce qui traumatise les Français, ce sont les attentats qui ensanglantent le RER parisien.
Des attentats dans le RER parisien
Le 25 juillet 1995, à l'heure de la sortie des bureaux, une très violente explosion secoue une rame de RER qui pénètre dans la station Saint-Michel, à Paris. En quelques minutes, le quartier est bouclé par la police. Dans le ciel, un hélicoptère de la sécurité civile évacue les blessés vers les hôpitaux de la capitale. Le soir, les Français découvrent au journal de 20 heures l'horreur de l'attentat : dans la rame visée par l'explosion, sept voyageurs ont été tués et près de quatre-vingts sont blessés. Dans un café du boulevard Saint-Michel aménagé à la hâte en centre de tri, des dizaines de passagers ensanglantés ont passé leur après-midi à recevoir les premiers soins. Dans la soirée, les images de voyageurs blessés et traumatisés par l'explosion heurtent profondément les téléspectateurs des journaux télévisés. Dans leurs tentatives d'identifier les commanditaires de l'attentat, les médias évoquent une piste serbe, puis islamiste. Montrés du doigt, les représentants du FIS en Europe « condamnent avec force l'horrible attentat (47) ».
À l'époque, Jean-Louis Debré lui-même aurait été surpris par l'attentat : « Ses services s'attendaient à des opérations contre de hauts responsables islamistes, mais pas contre des Français », explique dans son livre Hubert Coudurier (48). Le soir même de l'explosion de Saint-Michel, le ministre de l'Intérieur est reçu par le président Chirac qui lui lance : « Je veux connaître les auteurs !
— Monsieur le président, je vais vous dire la différence entre un énarque et moi : je suis incapable de vous dire qui a fait le coup », aurait répondu Jean-Louis Debré (49)… Ancien juge d'instruction, le ministre de l'Intérieur suit l'enquête de près, y consacrant plusieurs soirées par semaine en compagnie du juge Jean-François Ricard. Le 31 juillet, les services algériens, qui semblent particulièrement bien renseignés sur les projets des commandos de Zitouni, affirment à leurs homologues français que deux groupes du GIA sont présents en France et que des commandos suicides pourraient être lancés contre l'Arc de triomphe ou la tour Eiffel. Concernant l'assassinat du cheikh Sahraoui, ils réaffirment qu'il a été commandité par Abdelkrim Dénèche, un opposant islamiste algérien réfugié en Suède.
Trois semaines plus tard, le 17 août, la série noire continue avec un nouvel attentat à la bombe place de l'Étoile à Paris. Dix-sept passants sont blessés. Un mois après le premier attentat de Saint-Michel, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, n'a toujours aucune piste sérieuse susceptible d'être présentée à l'opinion. Le surlendemain de ce deuxième attentat, une lettre surréaliste parvient à l'ambassade de France à Alger. Signée « Zitouni », elle demande à Jacques Chirac de se « convertir à l'islam » et de « reconsidérer ses positions sur le dossier algérien ». Pour la population française, prise en otage depuis plusieurs semaines par ce qu'elle croit être un « terrorisme islamiste », ce « communiqué du GIA » ordonnant à Jacques Chirac de se convertir à l'islam est évidemment une provocation majeure qui contribue à créer en France une atmosphère de psychose et d'islamophobie.
Et la série noire continue : le 26 août, un nouvel engin explosif est découvert le long de la voie TGV de Cailloux-sur-Fontaine, dans le Rhône. Le 31, la police judiciaire perquisitionne les domiciles de deux jeunes de Chasse-sur-Rhône, David Vallat et Joseph Jaime, où elle trouve des armes et de quoi fabriquer des engins explosifs. Les enquêteurs se mettent alors sur la piste d'un troisième homme : Khaled Kelkal.
Au cours de la première semaine de septembre, nouveaux attentats : le 3 septembre, l'explosion d'une bombe blesse quatre personnes à Paris, boulevard Richard-Lenoir ; le lendemain, une autre bombe est désamorcée dans le XV e arrondissement de Paris ; et le 7, une voiture piégée explose devant une école juive de Villeurbanne (Rhône), faisant quatorze blessés. (Cette violence, qui bouleverse la France, est comme un écho de celle, beaucoup plus meurtrière, qui déchire alors l'Algérie. Pour ne citer que quelques cas : le 2 septembre, l'explosion d'une bombe à Meftah fait plus de trente morts et une centaine de blessés ; le 3, deux religieuses de la Congrégation Notre-Dame-des-Apôtres, sont tuées à Alger ; entre le 3 et le 10, quatre journalistes sont assassinés, quarante militaires sont tués dans une embuscade près de Batna, etc. (50)).
Le 17 septembre, deux campeurs suspects signalés à une brigade de gendarmerie lyonnaise s'enfuient précipitamment. Derrière eux, ils abandonnent un sac contenant un fusil Winchester qui se révélera être l'arme ayant servi à tuer l'imam Sahraoui quelques semaines auparavant. Moqué depuis plus d'un mois par une partie de la presse française qui lui reproche son inefficacité, Jean-Louis Debré croit tenir enfin des coupables : il lance une chasse à l'homme contre Kelkal et son acolyte. Quelques jours plus tard, le jeune beur lyonnais est repéré près d'un arrêt de bus au lieu-dit Maison-Blanche, dans les Monts du Lyonnais. Est-il vraiment le responsable du réseau terroriste qui met la France à feu et à sang depuis deux mois, comme l'a laissé entendre à plusieurs reprises Jean-Louis Debré ? Pour le savoir, il faudrait le juger, ou au moins pouvoir l'interroger. Mais dans les heures qui suivent son signalement, le 29 septembre, Kelkal est blessé par balle, puis achevé par les gendarmes. Arrivé sur place dans leur sillage, un journaliste reporter d'images de M6 filmera la fin de l'exécution. Sur la cassette, alors que Kelkal est blessé à terre, on entend distinctement l'un des gendarmes dire à son collègue : « Finis-le ! » (51).
À la suite de cet épisode, le dirigeant socialiste Lionel Jospin s'interroge sur LCI sur la responsabilité de Kelkal dans l'ensemble des attentats. Furieux, Jean-Louis Debré passe alors un « savon » à l'un des responsables politiques de la chaîne câblée (52). Mais le 17 octobre, signe que Lionel Jospin s'était posé une bonne question, une nouvelle bombe explose dans le RER parisien, entre les stations Musée d'Orsay et Saint-Michel. Cette fois, il s'agit d'une bouteille de gaz. On relève une trentaine de blessés.
Le 1 er novembre, enfin, Boualem Bensaïd, un homme que la police considère comme l'un des principaux responsables de la campagne terroriste, est arrêté à Paris. Avec Ali Touchent, son principal complice toujours en fuite, il aurait coordonné la campagne d'attentats.
Ali Touchent : une taupe des services algériens chez les islamistes
Emmené à la Division nationale antiterroriste, Bensaïd y est sévèrement interrogé : « Je donne un faux nom, on me tabasse, on me dit que la Sécurité militaire algérienne se trouve dans le bureau d'à côté, qu'ils savent tout et qu'ils veulent une histoire (53). » Le lendemain, un nouveau groupe est interpellé, cette fois à Lille. Le 4 novembre, c'est Rachid Ramda, présenté par la police comme le financier des attentats, qui est arrêté en Grande-Bretagne. En apparence, donc, le réseau terroriste qui prend le gouvernement Juppé en otage depuis plusieurs mois est enfin tombé. Mais bizarrement, Ali Touchent, qui est le véritable coordinateur de la campagne d'attentats, échappe miraculeusement à toutes les arrestations. Neuf ans après les faits, plusieurs témoignages permettent de mieux comprendre les liens qu'il entretenait avec les réseaux islamistes, mais surtout avec le DRS.
Originaire du quartier Chevalley, à Alger, Touchent fréquente dans les années 1980 la mosquée Al-Arkam, celle où prêche Mohamed Saïd, dont il est un fervent admirateur. Au début des années 1990, il arrive en France dans le but d'y étudier, mais rencontre bientôt des difficultés pour faire renouveler son titre de séjour. Fiché par les Renseignements généraux, repéré par la DST, il est contacté à Paris début 1993 par le DRS : « Il a été sollicité par un de nos officiers à Paris pour des renseignements tout à fait anodins », affirme aujourd'hui l'ex-colonel Samraoui, qui précise qu'à partir de cette époque, Ali Touchent accepta de coopérer et d'entretenir des contacts réguliers avec les services algériens (54). En contrepartie, il a bénéficié de la régularisation de sa situation vis-à-vis du service national et obtenu le renouvellement de sa carte de séjour en France.
D'après Samraoui, l'« agent Touchent » était « traité » en Europe par un de ses collègues, le colonel « Habib » Souamès, patron du DRS à l'ambassade d'Algérie à Paris. Au cours de l'année 1993, Souamès a ainsi permis à Touchent de se rendre à plusieurs reprises en Algérie. À cette période, le jeune homme a même bénéficié de la part des services de son pays d'une aide financière pour se marier et faire venir son épouse en France (55). Samraoui explique que la mission de Touchent était « d'infiltrer » les milieux islamistes européens pour le compte du DRS. Fin 1993, il a ainsi apporté sa contribution à l'« opération Chrysanthème », l'une des premières rafles organisées en France contre les islamistes algériens, en informant le DRS de la présence d'islamistes radicaux dans un foyer Sonacotra de L'Haÿ-les-Roses, en région parisienne (voir supra , chapitre 18). En 1994, il infiltre les milieux islamistes belges, et notamment l'entourage d'Ahmed Zaoui, un haut responsable du FIS qui embarrasse Alger. Le 1 er mars 1995, cette opération d'infiltration se solde par de nombreuses arrestations à Bruxelles, mais Zaoui, lui, est expulsé vers la Suisse.
Protégé par le DRS, Touchent échappe comme d'habitude à la police : « Nous donnions aux services occidentaux des informations sur les réseaux montés par Touchent, mais pas sur Touchent lui-même », nous a expliqué Abdelkader Tigha, ex-sous-officier du DRS et témoin direct de la manipulation du GIA. « Du coup, il a toujours échappé aux arrestations. Évidemment, nous n'avons jamais révélé aux services occidentaux que c'était notre agent. Concrètement, il était manipulé par le CPMI de Ben-Aknoun, mais comme c'était nous, au CTRI, qui détenions le “dossier GIA”, nous avions aussi notre mot à dire sur les actions ordonnées à Touchent. C'est nous qui avons exporté des attentats en France. On a dit : “Il faut faire quelque chose sur Paris” (56). »
En avril 1995, nommé « responsable du GIA en Europe », Touchent reconstitue à Chasse-sur-Rhône un « réseau » composé de jeunes Maghrébins désireux d'en découdre. Certains vivent dans la région lyonnaise, mais d'autres lui sont envoyés d'Algérie, soit par Djamel Zitouni, soit directement par le DRS, qui a supervisé la constitution du réseau : d'après le capitaine Ouguenoune, qui travaillait alors à Paris sous les ordres du colonel Souamès, deux agents chargés de coordonner au moins deux des attentats de l'été 1995 furent envoyés en France par le DRS. Quant aux jeunes recrutés dans la région de Lyon, ils auraient également été manipulés, mais à leur insu : « Les jeunes comme Khaled Kelkal ignoraient que Touchent travaillait pour nous, nous a expliqué Tigha. Manipuler l'ensemble du groupe aurait été trop risqué : en cas d'arrestation, ils auraient pu dire : “C'est le capitaine Abdelhafid Allouache, du CTRI de Blida, qui nous a envoyés !” Cela aurait fait scandale (57)… »
Des attentats « pédagogiques »
Aujourd'hui, le capitaine Ouguenoune affirme que c'est son propre chef, le colonel Souamès, qui coordonnait la campagne d'attentats depuis Paris avec Ali Touchent (58). Au printemps 1995, les réunions se multiplient à Bron, dans la banlieue lyonnaise, ou à Gonesse, en région parisienne, entre Ali Touchent et ses jeunes recrues. De « taupe » chargé d'infiltrer des réseaux islamistes, l'agent du DRS se mue en agent provocateur : il incite les membres de son réseau à commettre des attentats en France, pour le plus grand profit des généraux du clan éradicateur.
Systématiquement attribués par la presse aux « islamistes du GIA », les attentats de l'été 1995 vont en effet mettre en difficulté le gouvernement d'Alain Juppé et rendre intenable sa position nuancée sur le dossier algérien. Comment, en effet, relativiser la violence islamiste et prendre de la distance avec le régime des généraux dans un contexte où, chaque semaine, des Français meurent ou sont blessés dans des attentats réputés être l'œuvre d'islamistes algériens fanatiques ? Pour Abdelkrim Ghemati, un membre important de l'Instance exécutive du FIS à l'étranger, c'était précisément l'objectif recherché par le DRS : « Il s'agissait d'entretenir au sein de l'opinion publique un malaise, une crainte, une peur viscérale de tout ce qui peut ressembler à un islamiste (59). »
Pour les exilés du FIS, alors fréquemment assimilé au GIA par les médias, ces attentats sont évidemment catastrophiques. Le 9 octobre 1995, suite à un second « communiqué du GIA » revendiquant les attentats, Anouar Haddam le qualifie de « faux » et de « manipulation grossière ». Mostafa Brahami, ancien député islamiste réfugié en Suisse, nous a confirmé que le FIS n'avait à l'époque « aucun intérêt stratégique à se priver de sa base islamiste en France ni à se couper des aides financières qu'il pouvait recevoir de ce pays (60) ». « Pour nous, renchérit Mustapha Habès, élu du FIS en 1991 et désormais réfugié en Europe, la France était un portail de respiration. Ces attentats semaient la pagaille sur un terrain qui n'était pas le nôtre. C'était une catastrophe pour les islamistes s'efforçant de combattre le régime d'Alger (61). »
La Sécurité militaire algérienne, commanditaire des attentats de Paris ? L'hypothèse ne choque pas le juge Alain Marsaud, ancien chef du service central de lutte antiterroriste : « Dans les années 1980, on s'est rendu compte que le terrorisme d'État utilisait des “organisations écran”. En l'espèce, on peut considérer qu'à un moment ou à un autre, le GIA a été une organisation écran [du DRS] pour porter le feu en France, pour prendre la France en otage (62)… »
« Alger avait intérêt à ce que les pays d'Europe prennent des positions plus dures contre les islamistes, confirme aujourd'hui un proche conseiller de Charles Pasqua. Tout le monde sait que Touchent a été manipulé. » Proche des services de renseignement et spécialiste des « coup tordus », cet homme de l'ombre ajoute : « Entre deux attentats, les voyous qui les commettent doivent bien vivre : il faut manger, se déplacer, voyager, acheter des armes, trouver des logements, acheter des passeports… Un type comme cela, cela peut coûter 40 000 francs, 50 000 francs par mois. Si vous en avez dix, cela fait 500 000 francs par mois, soit 6 millions pour un an (900 000 euros). C'est le bénéfice d'une grosse PME (63). » Laissant entendre que les islamistes étaient incapables de financer de telles opérations, l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur conclut : « Il n'y a pas de mystère, vous savez, dans la vie… » Pour cet homme parfaitement informé — et cela ne le choque pas outre mesure —, le doute n'est pas permis : les attentats de Paris ont bien été une opération de guerre psychologique organisée et financée par le DRS.
« Les services algériens utilisent la carotte et le bâton, déplore aujourd'hui Hocine Aït-Ahmed, président du FFS. La carotte en achetant des complicités avec des valises, et le bâton en menaçant, de manière très sophistiquée, de créer de la violence en France (64). » Une méthode qui s'est révélée fort efficace en cet été 1995. Le 17 août, Jean-Louis Debré a ainsi interdit d'importation en France du Livre blanc sur la répression en Algérie , un ouvrage très précisément documenté sur les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité en Algérie depuis 1992, que nous avons déjà souvent cité, publié par des militants proches du FIS exilés en Suisse. Et après les attentats de 1995, pratiquement plus aucun responsable politique français n'osera critiquer le régime algérien comme si, au fond, ils avaient compris qu'Alger était derrière les attentats.
La France, otage ou complice ?
En ce début juillet 2002, l'homme qui s'enfuit à grandes enjambées dans les couloirs du Palais de justice de Paris n'a pas l'habitude de se laisser contrarier par des journalistes. Bien que retiré des affaires, le général Khaled Nezzar est l'un des principaux barons du régime algérien. Lors des émeutes d'octobre 1988, on l'a vu (voir supra , chapitre 5), il avait ordonné à ses troupes de tirer sur la foule, provoquant la mort de plusieurs centaines de jeunes à Alger. Mis en cause à ce sujet en mai 2001 par l'ex-lieutenant Habib Souaïdia, ancien officier des forces spéciales de l'armée, lors d'un débat télévisé sur « La Cinquième », il avait décidé de porter plainte en diffamation. Conscient que la justice de son propre pays n'avait plus aucune crédibilité à l'étranger, c'est à la justice française qu'il demandait de le rétablir dans son honneur et de lui reconnaître un rôle positif dans l'histoire récente de l'Algérie (il sera sèchement débouté par le tribunal, nous y reviendrons).
Mais devant la 17 e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le vieux général a perdu de sa superbe. Confronté au fil des jours aux témoignages terribles des victimes de la répression qui sévit depuis 1988, visé par des plaintes pour torture, il quitte chaque soir la salle d'audience par une porte dérobée, comme pour échapper aux journalistes. Ce jour-là, nous le rattrapons dans l'un des couloirs du Palais de justice pour le questionner sur le rôle du DRS dans les attentats de Paris en 1995. Estomaqué par la question, le général Nezzar revient sur ses pas, avec une terrible rage dans le regard. Mais à notre grande surprise, loin de nier que des liens aient pu exister entre le GIA et le DRS, il renvoie la balle aux autorités françaises : « Allez voir vos services, ils connaissent très bien le problème, je m'excuse…
— Vous voulez dire que les services secrets français sont au courant ?
— Ils doivent être au courant
— C'est ce qui se confirme dans notre enquête, effectivement…
— Alors allez les voir, confirmez et condamnez-nous (65)… »
Certains hauts responsables français savaient-ils dès 1995, comme le laisse entendre le général Nezzar, que les organisateurs des attentats de Paris, officiellement membres du GIA, travaillaient en réalité pour le DRS ? Plusieurs indices convergents le confirment. Dans l'entourage d'Alain Juppé, dès les premiers attentats, les soupçons se portent sur les services algériens : « C'est sans aucun doute le travail des islamistes, confie à l'époque l'un des conseillers du Premier ministre. Mais qui est derrière eux ? Peut-être un clan de la Sécurité militaire algérienne ou du pouvoir qui voudrait nous entraîner comme allié dans leur combat contre le terrorisme (66) ? » Le 19 août 1995, l'outrancier communiqué de Zitouni, ordonnant à Jacques Chirac de se « convertir à l'islam » et de « changer de politique sur l'Algérie », apporte de l'eau au moulin de ceux qui soupçonnent le GIA de servir de couverture au DRS (67).
Dans le courant du mois d'août, d'autres indices montrent que le DRS entretient des liens étranges avec les commandos terroristes agissant en France. À la veille de chaque attentat, un mystérieux Algérien prévient par exemple un inspecteur des Renseignements généraux que « quelque chose va se passer » : « À la fin, on trouvait cela un peu particulier, se souvient Jean Lebeschu, alors officier aux Renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris. Dès que cet individu appelait, il disait que cela allait péter (68). » À la fin de l'été, cet officier des RG acquiert la certitude que l'Algérien qui renseigne son collègue sur les attentats est un officier du DRS : « Il en avait la méthodologie et la volonté, il n'a jamais été arrêté, on n'en a jamais parlé, donc c'est fatalement un type couvert par notre hiérarchie. Il faisait partie de l'entente entre les services algériens et nous-mêmes (69). »
Cette hypothèse ne surprend pas l'ancien magistrat antiterroriste Alain Marsaud : « Cela ne sert à rien de commettre des attentats si vous ne faites pas passer le message et si vous ne forcez pas la victime à céder. Cela s'obtient par la mise en place d'une diplomatie parallèle destinée à bien faire comprendre d'où vient la menace et comment on peut y mettre fin en contrepartie de certains avantages (70)… » Selon l'ancien chef du service central de lutte antiterroriste, c'est donc à une véritable prise d'otage du gouvernement Juppé que se seraient livrés les chefs du DRS par GIA interposé. Et la manipulation n'aurait pas échappé à la DST.
Fin août 1995, Abbas Aroua, un universitaire proche du FIS et vivant à Genève, se rend en France pour y distribuer quelques exemplaires du Livre blanc sur la répression en Algérie , cet ouvrage collectif qui vient d'être interdit d'importation en France par les services de Jean-Louis Debré : « Je comptais en remettre quelques exemplaires à des journalistes », nous a raconté l'intellectuel algérien. Arrêté dans le TGV, il se voit confisquer les exemplaires qu'il transporte et est conduit au commissariat de Pontarlier, où on lui annonce qu'il va être interrogé par la DST. « J'ai attendu trois heures, et un policier français en civil est arrivé, relate Abbas Aroua. Toute notre discussion a porté sur les attentats qui ensanglantaient Paris. Je lui ai dit : “Les commanditaires, ce sont vos amis de la Sécurité militaire !
— Oui, nous avons établi l'implication des services algériens et nous l'avons signalé dans un rapport que nous avons remis aux autorités”, m'a-t-il répondu en substance (71). »
Une révélation aujourd'hui partiellement confirmée par Alain Marsaud : « C'est vrai qu'une des réflexions de la DST, cela a été de constater que dès qu'on remontait les réseaux Kelkal, on tombait sur des gens des services officiels algériens (72). »
Jean-Louis Debré, le ministre français de l'Intérieur, est évidemment informé de ces soupçons devenus certitudes. À la mi-septembre, alors que la France est prise en otage depuis près de deux mois par le terrorisme du GIA, il décide de dénoncer publiquement, par une manœuvre oblique, les manipulations du DRS. Il invite des journalistes à déjeuner au ministère de l'Intérieur et leur fait passer un message : « Il se demandait si une manipulation des autorités algériennes était possible, se souvient Dominique Gerbaud, à l'époque journaliste à la Nouvelle République du Centre-Ouest et président de l'Association de la presse présidentielle. Cela nous a semblé être une information de toute première importance, en tout cas une information nouvelle (73). » Le lendemain de ce déjeuner, les journalistes invités par le ministre de l'Intérieur publient ses propos selon lesquels, suite aux attentats, « la Sécurité militaire algérienne voulait que l'on parte sur de fausses pistes pour qu'on élimine des gens qui la gênent » (74).
Repris à la « Une » du Monde , ces propos du ministre de l'Intérieur provoquent la colère d'Alger. Jean-Louis Debré va alors faire semblant de ne pas avoir dit ce qu'il a dit. Dans son entourage, on « dément formellement l'existence de l'interview » et on se « réserve d'examiner toutes les suites judiciaires que mérite cette affaire (75) ». Mais quelque temps plus tard, Debré confirme ses propos à Hubert Coudurier : « Il m'a dit qu'il avait fait ses déclarations sciemment, que c'était une manière de faire passer un message aux autorités algériennes pour qu'elles arrêtent de nous “bourrer le mou”, nous a expliqué le directeur de rédaction du Télégramme de Brest . Pour des raisons diplomatiques, Debré a démenti ensuite ses propos. Mais le message était passé (76)… » Confronté à ses propres déclarations lors d'une rencontre filmée en octobre 2002, Jean-Louis Debré n'a pas souhaité nous répondre…
Selon Hubert Coudurier, Jean-Louis Debré aurait donc clairement signifié aux autorités algériennes qu'elles étaient allées trop loin dans l'instrumentalisation du GIA… Suite à cet épisode, Alain Juppé lui-même aurait donné des consignes pour que les enquêteurs français « limitent à l'extrême », voire « coupent tout contact » avec les services algériens de renseignement (77). En octobre 1995, le conseiller diplomatique du président Jacques Chirac à l'Élysée, Dominique de Villepin, l'aurait même encouragé à accepter une rencontre avec le président Zéroual pour lui renouveler le message de Jean-Louis Debré sur le thème : « Arrêtez de nous raconter des histoires (78). »
À l'époque, l'ancien Premier ministre algérien Abdelhamid Brahimi recueille les confidences d'un proche du président français, qui lui confirme que Paris a parfaitement compris que le DRS était derrière les attentats et qu'un messager envoyé par Chirac à Zéroual fin 1995 était chargé de faire passer le message. Difficilement vérifiable, ce témoignage est cependant à rapprocher de deux visites effectuées à l'époque à Alger : celle du sénateur Xavier de Villepin, chargé de rencontrer les décideurs algériens pour déterminer les responsabilités des uns et des autres ; et celle de Philippe Seguin, le président de l'Assemblée nationale, le 22 décembre 1995. Arrivé dans l'avion présidentiel de Jacques Chirac, ce dernier est porteur d'un message du président français à son homologue algérien.
Cette visite fait d'ailleurs l'objet d'un communiqué commun diffusé par l'agence officielle du régime, l'APS. Mais le soir même, l'Élysée minimise étrangement la rencontre entre le président Zéroual et Philippe Seguin en diffusant un communiqué affirmant que ce dernier n'était porteur d'aucun message de Jacques Chirac (79). Pourquoi un tel communiqué ? Le message de Jacques Chirac à Liamine Zéroual devait-il rester confidentiel ? D'après Abdelhamid Brahimi, la teneur de ce mystérieux message était explosive : « Mon informateur m'a affirmé que le message du président Chirac disait notamment que la France n'accepterait jamais à l'avenir que la Sécurité militaire organise des attentats en France (80). »
Conscient de l'instrumentalisation du GIA par le DRS, Paris va pourtant protéger Alger. D'abord en laissant croire que les islamistes algériens sont bien responsables des attentats, ensuite en laissant fuir Ali Touchent, pourtant considéré par les enquêteurs comme le principal organisateur de la campagne terroriste. Comment expliquer, en effet, que Touchent, connu par la DST depuis la découverte de papiers d'identité portant sa photo lors de l'« opération Chrysanthème » en novembre 1993, ait systématiquement échappé à toutes les arrestations depuis cette date ? Comment comprendre qu'en novembre 1995, sur les soixante « islamistes » répertoriés dans l'album des services de police, la photo de Touchent soit accompagnée de la simple mention : X, dit « Tarek », comme si les services français ne le connaissaient pas ? Qui cherchait à le dissimuler à la justice française ? La police savait pourtant que l'« émir » du GIA en France partageait la chambre de Boualem Bensaïd boulevard Ornano, dans le XVIII e arrondissement de Paris, puis rue Félicien-David, dans le XVI e . Comment expliquer qu'après les attentats, Touchent, présenté par Alger comme le numéro un du GIA en Europe, ait pu se réfugier… en Algérie, alors même qu'il était recherché par toutes les polices et que son portrait était largement diffusé ?
« C'est nous qui l'avons aidé à regagner Alger », sourit aujourd'hui l'ex-adjudant Abdelkader Tigha. Une fois en Algérie, Touchent s'installe, sans se cacher, dans une cité d'Alger réservée aux policiers et située dans un quartier hautement sécurisé (81). À l'annonce de sa mort, en février 1998, les enquêteurs français ne prennent même pas la peine de se rendre sur place pour vérifier son décès : « Les services français savaient que Touchent était un agent du DRS chargé d'infiltrer les groupes de soutien aux islamistes à l'étranger, a expliqué dans son livre l'ex-colonel Samraoui. Profitant de l'intimité de leurs relations avec la DST, le général Smaïl Lamari et le colonel Habib lui fournissaient de vrais “tuyaux” sur le mouvement islamique en France et sur les éléments “dangereux” identifiés par les taupes du DRS, dont Ali Touchent ; en échange de ces précieuses informations, la DST apportait sa collaboration (y compris la protection des sources, ce qui explique pourquoi Ali Touchent n'a jamais été inquiété sur le territoire français) et son soutien pour neutraliser les vrais islamistes (82). »
Confronté à ces très graves accusations lors du procès des responsables présumés des attentats de Paris en octobre 2002, Roger Marion, ancien responsable de la Division nationale antiterroriste, a confirmé qu'il était « possible » qu'il y ait eu « rétention d'informations par un service ou un autre » sur le cas de « Tarek » (Ali Touchent) et que les informations existantes sur lui avaient peut-être été « portées tardivement » à la connaissance de la police, une façon de reconnaître que Touchent avait probablement été protégé par la DST. Suite à ces déclarations calamiteuses, Jean-François Clair, numéro deux du contre-espionnage français, a reconnu des contacts avec le frère de Touchent, mais pas avec l'organisateur des attentats lui-même, qui n'aurait pas été identifié avant le 11 novembre 1995 (83). « Ce qui semble le plus probable, estime aujourd'hui l'ex-colonel Samraoui, c'est que les responsables de la DST, aveuglés par leurs relations étroites avec Smaïn et consorts, n'ont rien fait pour les empêcher, ne soupçonnant sans doute pas que leurs homologues algériens étaient prêts à aller aussi loin. Et ensuite, la DST a tout fait pour jeter le voile sur cette attitude (84). »
Mais le plus étonnant, dans toute cette histoire, est que la vérité de ce secret d'État sera connue assez rapidement, de la façon la plus officielle, sans que les médias français s'en émeuvent particulièrement. Ainsi, lors du procès des membres du réseau de Chasse-sur-Rhône, ouvert à Paris le 26 novembre 1997, Hamid Herda et Joseph Jaime, anciens complices d'Ali Touchent, l'accusèrent de les avoir utilisés pour le compte du DRS, ce qui fut bien peu relevé à l'époque (85).
« Il faudrait que les familles des victimes se manifestent et demandent aux politiques français d'arrêter de soutenir les criminels au pouvoir à Alger, lance aujourd'hui Abdelkader Tigha. Il faudrait reconnaître les responsabilités des services, voire dédommager les victimes, comme dans l'affaire de Lockerbie ou de la Libye ! On voit bien que ce n'est pas le père de Nicolas Sarkozy qui fut kidnappé avec les moines de Tibhirine, ni la fille de Jacques Chirac qui est décédée dans les attentats du RER. Sinon, cela ne se serait pas passé comme cela (86) ! »
Notes


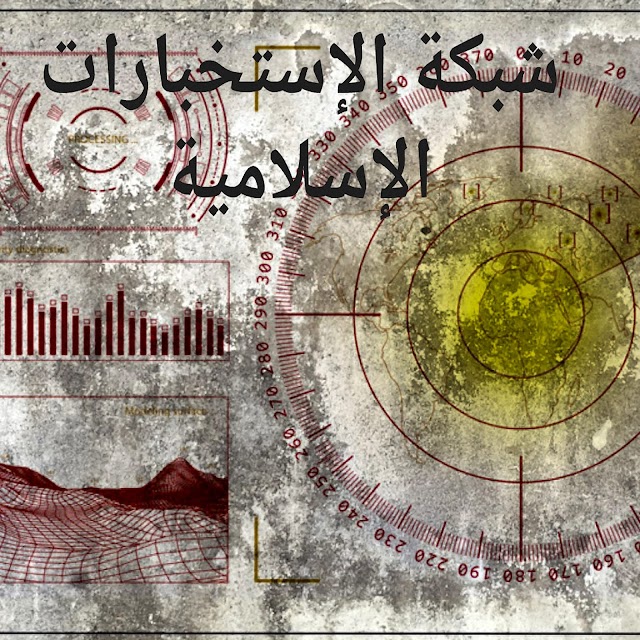



0 Comments