NDLR: Selon differentes sources, l'agent de la France-Israel, Mediene dit Toufik, a accepte de se rendre pour eviter les juridictions internationales. Ce sont les reseaux de Toufik qui ont mis a disposition les documents secrets prouvant l'implication directe de Sarkosy dans les recentes operations sionistes dans la region, une partie de ces documents sont en cours d'analyse et une autre partie authentifiee est arrivee devant la Cour Penale International. Les documents confirment l'implication tres etroite de trois autres pays europeens dans le genocide algerien.
L'ALGERIE DES GENERAUX
De Lyès Laribi
Max Milo éditions,
Extraits :
(…) Hachemi Sahnouni a pris la parole juste après Mohamed Saïd pour le fustiger, l’accusant d’être de connivence avec l’État, et d’être contre l’émergence du parti de Dieu. Ces paroles ont incité quelques personnes surchauffées à avancer vers Mohamed Saïd et à proférer des insultes et des menaces contre lui. Ali Benhadj est venu apporter son soutien à Mohamed Saïd, en s’interposant face aux fidèles de Sahnouni. Sans son intervention, qui a réussi à calmer les esprits, un lynchage aurait sans doute eu lieu. Juste après cet incident, Sahnouni reprendra la parole et lancera un avertissement contre tous ceux qui oseront entraver la constitution du FIS : « Ce parti verra sa naissance quel que soit l’avis de Mohamed Saïd », a-t-il dit. Le « prédicateur DRS » tenait à ce que les ordres reçus soient exécutés. Ali Djeddi et Abdellah Djaballah se sont retirés pour protester contre la façon dont Mohamed Saïd avait été traité.
(…) Hachemi Sahnouni a pris la parole juste après Mohamed Saïd pour le fustiger, l’accusant d’être de connivence avec l’État, et d’être contre l’émergence du parti de Dieu. Ces paroles ont incité quelques personnes surchauffées à avancer vers Mohamed Saïd et à proférer des insultes et des menaces contre lui. Ali Benhadj est venu apporter son soutien à Mohamed Saïd, en s’interposant face aux fidèles de Sahnouni. Sans son intervention, qui a réussi à calmer les esprits, un lynchage aurait sans doute eu lieu. Juste après cet incident, Sahnouni reprendra la parole et lancera un avertissement contre tous ceux qui oseront entraver la constitution du FIS : « Ce parti verra sa naissance quel que soit l’avis de Mohamed Saïd », a-t-il dit. Le « prédicateur DRS » tenait à ce que les ordres reçus soient exécutés. Ali Djeddi et Abdellah Djaballah se sont retirés pour protester contre la façon dont Mohamed Saïd avait été traité.
Le vendredi 10 mars 1989, le FIS est né à la mosquée « Ibn Badiss » de Kouba. Abdelbaki Sahraoui l’a annoncé aux fidèles présents durant ce jour de prière. Mais on retiendra surtout les contradictions au sein de la mouvance islamiste : certains n’étaient absolument pas favorables à une politisation de l’islam. Ainsi, les salafistes (adeptes d’un islam rigoriste), qui représentaient le courant majoritaire parmi les initiateurs du Front Islamique du Salut, se sont retrouvés divisés en deux tendances : les salafistes scientifiques considéraient la participation au jeu politique comme contraire aux lois islamiques. Ces idées étaient prônées par les prédicateurs Abdelmalek et Elaïd de la mosquée « La Colonne » de Hydra. Les salafistes combattants, plus connus sous le nom de « djihadistes », prêchaient, eux, le combat et le djihad pour la restauration du califat.
Cette tendance était elle-même divisée en deux mouvances : la première considérait que le jeu démocratique, même s’il avait pour objectif d’instaurer une République islamique, était tout à fait contraire aux préceptes de l’islam que seul le djihad pouvait accomplir, et que toute participation au jeu politique était considérée comme impie. Cette mouvance a pour nom « El Mouahidoun », plus connue sous le nom de « El Hijra oua Takfir », à savoir « Exil et Expiation ». Elle avait comme prédicateur un ancien officier de l’armée, le docteur Ahmed Bouamra (tué par les services algériens en prison), ancien de la guerre d’Afghanistan. L’autre mouvance des « djihadistes » était participationniste. Elle considérait que l’utilisation d’un parti politique pour instaurer une République islamique était licite, mais qu’une fois la République islamique acquise, le parti n’avait plus de raison d’être. Cette mouvance était représentée par la majorité des prédicateurs qui ont œuvré à la création du FIS, dont Ali Benhadj et Sahnouni. C’est cette mouvance qui arrivera à récupérer la majorité des salafistes (même les « Afghans ») et à les canaliser.
Quant à l’autre courant de pensée, proche des Frères musulmans avec ses trois tendances, à savoir les « internationalistes » de Mahfoudh Nahnah, les « djazaristes » de Mohamed Saïd, et les « nahdaouis » de Djaballah, il était contre l’idée de la création d’un parti représentant à lui seul la mouvance islamiste, et ce, d’autant plus que les initiateurs étaient des salafistes. Ces derniers considéraient que toute personne prônant une autre idéologie que la leur était impie. Par ailleurs, cela venait contrecarrer le travail de la ligue de la « Daawa » du cheikh Sahnoun, où ce courant de pensée, proche des Frères musulmans, était majoritaire, alors que le courant salafiste était quasi inexistant. Les salafistes tirent leurs jurisprudences des savants saoudiens, donc de l’école médinoise , tandis que les frères musulmans tirent leurs jurisprudences des savants égyptiens, donc de l’école d’El-Azhar.
Ainsi la mouvance islamiste est passée de deux à six tendances avec l’apparition du politique, et, de jour en jour, le fossé n’a cessé de grandir entre les différentes factions.Le 10 mai 1989, Abassi Madani a été désigné, par le conseil consultatif, président du FIS et seul porte-parole. Mais au cours de cet été 1989, beaucoup de conflits ont éclaté dans les mosquées pour le contrôle des différentes factions, sous l’œil passif et complice des services de sécurité.
In Les faux processus de démocratisation et la seconde guerre d’Algérie - la création du FIS (p76 à 78).
(…) L’armée pouvait ainsi surveiller les hommes politiques et contrôler les sphères de décision. Cela ne fut pas une surprise pour de nombreux spécialistes de la question algérienne, car en réalité, le ministre de la Défense, Nezzar, en décembre 1990, au moment où il avait nommé Touati, Lamari et Taghrirt comme conseillers du ministre de la Défense, avait déjà élaboré une demande de type « état-major », pour le cas où le FIS aurait dépassé les prévisions et les probabilités des militaires, et aurait alors échappé à tout contrôle extérieur ou intérieur. Ainsi cette « intelligentsia » avait élaboré une stratégie en plusieurs points, de façon à ce que les généraux ne puissent en aucun cas perdre le contrôle du pouvoir. Il fallait réaliser par tous les moyens, même illégaux (fraude électorale, manipulation de l’opinion), les conditions du succès électoral pour n’importe quel parti ne remettant pas en cause les intérêts des généraux. Parallèlement, il fallait tenter de neutraliser par des moyens légaux les formations dites « hostiles », islamistes ou non, avant l’échéance électorale. L’exploitation de leurs antagonismes était une nécessité. La naissance du parti islamiste Hamas du cheikh Nahnah, en décembre 1990, faisait partie de cette stratégie. Hichem Aboud rapporte dans son témoignage que la veille de la création de ce parti, il avait vu Mahfoudh Nahnah sortir du bureau du général Betchine, alors patron de la Sécurité Militaire.
Le 2 juin 1990, des milliers d’étudiants ont manifesté sur le front de mer jusqu’à la place des Martyrs, apportant leur soutien au FIS, malgré le quadrillage policier et l’utilisation de bombes lacrymogènes par les forces de l’ordre. La nuit même, Mouloud Hamrouche et son gouvernement ont été destitués, et les troupes d’élites de la gendarmerie et de la police ont évacué les militants du FIS des places publiques par la force. Bilan bien lourd : quatre-vingts morts selon les ONG, treize morts et soixante blessés selon la police.
Le 4 juin, l’état de siège a été décrété. Sid Ahmed Ghozali a été coopté chef du gouvernement à la place de Mouloud Hamrouche. Il fallait éliminer l’homme des réformes, un personnage jugé non docile, et le remplacer par un exécutant de basses œuvres. Les généraux voulaient assurer leurs arrières financiers (ainsi en 1994, alors que l’Algérie était en cessation de paiements, les avoirs de ces derniers à l’étranger étaient évalués à environ 34 milliards de dollars, dont dix-sept en France ).
Le 7 juin, Abassi Madani a annoncé la fin de la grève, suite à un accord qu’il aurait conclu avec le chef du gouvernement, Sid Ahmed Ghozali, mais que ce dernier niera. Selon le dirigeant du FIS, l’accord stipulait que le parti islamiste s’engageait à faire cesser la grève et les hostilités si le pouvoir répondait favorablement à trois points : l’abrogation des textes sur le découpage électoral et la loi électorale, le respect des résultats des futures élections législatives et l’organisation d’une élection présidentielle anticipée. Ne voyant rien venir, le FIS a de nouveau appelé à une grève générale et demandé à ses militants, le 15 juin 1991, de réoccuper les rues. C’est dans ce contexte que les premiers maquis se sont constitués autour de quelques figures du mouvement islamiste radical : Chekendi à Chréa dans la Mitidja, Mekhloufi à Zbarbar, ainsi que Chebouti et Meliani (inculpés dans l’affaire Bouyali puis graciés par Bendjeddid en 1989, et dont Samraoui rapporte dans son témoignage qu’ils ont été relâchés dans le cadre d’un accord avec les services de sécurité afin d’infiltrer et de contrôler la tendance extrémiste). Ils ont voulu au départ réactiver le Mouvement Islamique Armé (MIA), cher à Bouyali, mais chacun est parti de son côté après leur désaccord.
In Les émeutes de juin 1991 ( p 98 à 100)
Une semaine après la mort de Mohamed Boudiaf, BP, Philips petroleum, Mobil, Atlantic Richter, ont obtenu des autorisations d’exploitation de gisements pétroliers .Au lendemain de la signature de l’accord, Sid Ahmed Ghozali a été remplacé à la tête du gouvernement par Belaïd Abdeslam, ancien ministre de l’Industrie sous Boumediene, un vieil apparatchik, qui a décrété l’économie de guerre, pourvu que cela ne le touche pas. Ali Kafi, un autre cacique du régime, secrétaire général de l’Organisation Nationale des Moudjahidines (anciens combattants de la guerre d’indépendance), a remplacé Mohamed Boudiaf à la tête du HCE, coquille vide, car le pouvoir réel est entre les mains des militaires. Lors de son éviction au profit de Zeroual, il a refusé de quitter sa résidence d’État, comme l’a fait aussi Sid Ahmed Ghozali, en sa qualité d’ambassadeur d’Algérie à Paris, après avoir été chef du gouvernement. Reda Malek a fait son entrée au Haut Comité d’État.
Le projet de Mohamed Boudiaf de créer un grand rassemblement (Rassemblement National Patriotique) a été dynamité par des conspirations de clan, auxquelles la main des dignitaires du régime n’était pas étrangère. Pendant ce temps, l’Algérie s’est enfoncée dans la guerre civile et la crise économique (elle est en cessation de paiement). En effet, elle traversait alors une crise économique sans précédent alors qu’elle était citée à la onzième position des pays producteurs de pétrole avec 1,8 % de la production mondiale, à la sixième position pour le gaz avec 2,7 % de la production mondiale et 4 % des réserves mondiales. Elle était confrontée à la difficulté de remboursement de sa dette engendrée par la chute des entrées en devises que représentait le pétrole, sa seule manne financière, dont les prix s’étaient effondrés. Sa situation de pays à risque (risque politique, vu l’instabilité qui y règne, et risque économique, vu sa dépendance vis-à-vis de ses seules ressources énergétiques) ne lui donnait droit qu’à des emprunts à brève échéance et à taux majoré, accentuant sa dépendance financière. Parallèlement, les importations étaient en hausse à cause de la pression démographique : elles représentaient 8,5 milliards de dollars, dont 2,5 milliards pour l’alimentation. Et n’oublions pas, de surcroît, le mal qui ronge tous les régimes totalitaires : la corruption. En effet, les commissions occultes représentaient environ 15 % du montant total des transactions.
Elles étaient – et sont toujours – partagées entre tous les protagonistes. La moitié de ces commissions est prélevée par les firmes étrangères pour différentes raisons, comme le surcoût du crédit international, ou le risque pays, tandis que l’autre moitié est répartie en deux parts égales, entre les commissions des managers des firmes exportatrices et les commissions versées dans des comptes étrangers à nos responsables. En Algérie, l’élaboration d’un cahier des charges se fait en fonction du fournisseur choisi : une transaction avec la Chine coûte moins cher qu’avec l’Italie, l’Espagne ou la France. Il y a un suivi minutieux des différentes phases de la transaction sous le parrainage d’un des hauts dignitaires du régime, et chacun a son rayon d’action. L’argent est viré sur un compte à l’étranger sous un prête-nom, celui d’un proche ou d’un homme d’affaires de confiance.
C’est ainsi qu’en Algérie le portefeuille du ministre de l’Intérieur assure l’attribution du terrain et du marché, le portefeuille du ministre des Finances assure les crédits et les facilités douanières, et le portefeuille du ministre de la Justice assure l’impunité en cas de problèmes judiciaires.
Ces postes ministériels ne sont octroyés qu’après caution des Généraux. Le cas de Mahi Bahi, ancien ministre de la Justice démis de ses fonctions le 14 novembre 1992 pour s’être attaqué à des magistrats et juges d’instruction soupçonnés de corruption, sans l’aval des décideurs, est l’un des exemples les plus significatifs de ce début des années 1990.
In Le GIA, Zeroual et le pétrole (p136-138)
Le massacre de la prison de Serkadji est intervenu à un moment où le peuple algérien était plongé dans la terreur, et il a provoqué la mort de dizaines de milliers de citoyens. Pour comprendre les raisons de ce massacre, il faut se remémorer la succession d’évasions spectaculaires réussies par les islamistes largement infiltrés par la DRS au sein des prisons algériennes. Certaines évasions ne peuvent être expliquées que par le fait qu’elles aient été voulues, car la présence de terroristes extrêmement dangereux au sein de ces établissements pénitenciers avait eu pour conséquence l’instauration de mesures de sécurité draconiennes. La première évasion à grande échelle a été celle de Tazoult, où mille deux cents détenus, pour la majorité condamnés pour des actes terroristes, ont réussi à prendre la fuite. Cette évasion qui touchait un symbole de haute sécurité a provoqué la démission du préfet de Batna. La prison de Lambèse est en effet considérée comme une forteresse où l’évasion est impossible. Elle possède son propre système de sécurité appuyé par un programme d’urgence qui prévoit une intervention dans un délai ne dépassant pas quinze minutes. Cette évasion spectaculaire reste donc un mystère. Des questions restent sans réponse aujourd’hui : comment une évasion d’une aussi grande ampleur a pu échapper aux services de renseignements, alors qu’ils arrivaient à démanteler les réseaux de soutien au terrorisme les plus minimes ? Pourquoi l’intervention des forces de sécurité a-t-elle été retardée ? Pourquoi, quelques jours auparavant, presque toutes les figures du terrorisme sanguinaire furent transférées dans cette prison ? Pourquoi Madani Mezrag, au sein de l’Armée Islamique du Salut, n’avait-il accepté parmi les fuyards que les hommes les plus sûrs, et qui appartenaient déjà à son groupe ?
Certaines de ces questions trouvent leurs réponses dans l’avènement de Djamel Zitouni à la tête du GIA et dans la dérive de ce groupe. Djamel Zitouni n’avait-il pas adopté un certain nombre de ses membres comme conseillers ? Il devait prendre la direction du GIA et avait besoin de soutiens pour asseoir son autorité, et il n’y avait pas meilleur moyen de réaliser cette infiltration au sein du GIA qu’en simulant une évasion. D’ailleurs, aucun dirigeant du FIS ne se trouvait dans cette prison. La plupart d’entre eux étaient soit à la prison de Berrouaghia, soit à Serkadji.
Le deuxième événement est le massacre de la prison de Berrouaghia, perpétré à l’automne 1994, suite à une tentative d’évasion. Mustapha, un homme du quartier qui avait purgé cinq ans dans cette prison pour appartenance à un groupe terroriste, m’a expliqué à sa sortie que, quelques jours avant cette journée fatidique, qui a coûté d’après lui la vie à plus de cent prisonniers, la rumeur de l’évasion s’était tellement répandue dans la cour de la prison, qu’il avait eu du mal à rejoindre l’infirmerie afin de se faire soigner. Universitaire de formation, Mustapha doutait de la sincérité du groupe qui était derrière cette évasion ; ses membres, arrivés seulement quelques mois plus tôt à la prison, disaient avoir réussi à amadouer un gardien en contact avec leurs frères de l’extérieur, et ces derniers devaient les attendre à l’extérieur de la prison pour les aider à rejoindre les maquis islamistes. Le jour dit, tous les prisonniers qui venaient de franchir la porte de la prison ont été abattus par une brigade d’élite qui les attendait. Le reste des prisonniers, qui n’ont pas été pris dans le guet-apens, ont été encerclés à l’intérieur de l’établissement et abattus.
Mustapha m’a expliqué que le plus dur était de rester en vie après une telle tragédie, avec le remords de n’avoir pas pu l’éviter. Lors de mon séjour entre 1999 et 2000 à la prison de Serkadji, des détenus de longues peines m’ont décrit le scénario de la tragédie : des actes atroces commis à l’arme blanche par un nombre réduit de mutins sur d’autres prisonniers et gardiens de prison ; des exécutions sommaires ; des mutilations pratiquées par les éléments des services spéciaux sur des prisonniers qui n’avaient absolument rien à voir avec la mutinerie. Et les détenus ont été exécutés de deux manières : les uns individuellement dans leurs cellules, les autres en groupe dans la cour de promenade.
Mustapha m’a dit : « Tout s’est passé vite. Au moment des faits, le temps n’avait plus aucune signification. Le nombre de jours que ça a duré, je ne m’en souviens pas. Deux ou trois jours . » Il se souvient qu’un des gardiens qui était à l’intérieur du premier bloc, connu sous le nom de Rtila (« araignée »), a réussi de justesse à franchir la porte principale qui fait entrer à l’intérieur des blocs, et a déclenché l’alarme. La prison de Serkadji est divisée en deux blocs : l’ancienne prison turque, et la nouvelle prison française. Les détenus islamistes occupent l’ancienne, et les détenus de droit commun, la nouvelle.
In Le massacre de la prison de Serkadji ( p 158 à 161)
Le 30 janvier 1995, un attentat à la voiture piégée a été commis contre le commissariat central d’Alger, faisant une quarantaine de morts et une centaine de blessés. Les personnes tuées étaient en majorité de simples citoyens présents sur le boulevard Amirouche, très animé. Djamel Zitouni, le nouvel émir du GIA, venait de signer le début d’un combat criminel téléguidé.
Le 11 juillet 1995, le terrorisme a traversé la Méditerranée pour frapper l’Hexagone. Sahraoui Abdelbaki, membre fondateur du FIS, et qui avait prononcé le prêche proclamant la naissance de ce parti, a été exécuté froidement par un tueur à l’intérieur de la salle de prière de la mosquée Myrha dans le 18e arrondissement à Paris, juste après la prière d’el asr. Un jeune, qui était à l’intérieur de la mosquée au moment des faits, a aussi trouvé la mort pour avoir tenté d’attraper le tueur. Ainsi, une fois la prière terminée, l’imam a été approché par une personne qui voulait discuter en tête à tête avec lui. Au moment où la mosquée s’est vidée, l’assassin a sorti son arme et a tiré. L’imam s’est écroulé. Nordine, un jeune de la Fraternité Algérienne en France (FAF) se trouvait encore dans la mosquée ; voyant la scène, il a attrapé l’assassin et l’a plaqué au sol. Malheureusement aucun des fidèles encore présents devant la porte de la mosquée ne lui a apporté son aide. Le deuxième tueur qui faisait le guet devant la porte lui a tiré dans le dos. Les deux tueurs, rejoints par un troisième complice à l’extérieur, ont remonté la rue Myrha à pas précipités, mais sans inquiétude, alors que l’un d’eux était couvert de sang. Au bout de la rue Laghouat, ils ont braqué une femme et lui ont pris sa voiture pour l’abandonner un peu plus loin au niveau de la rue du Nord. Ils ont pris une autre voiture qu’ils ont osé garer au pied de l’immeuble où ils avaient élu domicile. Ce premier attentat perpétré par le GIA sur une des personnes les plus surveillées sur le sol français était-il lié au fait que l’imam avait pris connaissance d’un probable attentat qui se préparait à Paris ? S’apprêtait-il à dénoncer les criminels au moment opportun ?
Le 25 juillet 1995, l’explosion d’une bonbonne de gaz dans une rame de RER à la station Saint-Michel, à Paris, a fait huit morts et quatre-vingt-trois blessés. Cet acte terroriste sera suivi par cinq autres et par deux autres tentatives qui échoueront de justesse : le 17 août, l’explosion d’une bonbonne de gaz dans le 8e arrondissement de Paris, faisant dix-sept blessés ; le 26 août, la tentative d’attentat sur la voie de TGV Lyon – Paris ; le 3 septembre, l’explosion d’une bombe boulevard Richard-Lenoir, faisant quatre blessés ; le 4 septembre, l’explosion d’une voiture devant une école juive, faisant quatorze blessés ; le 6 octobre, l’explosion d’une bombe à la station de métro Maison-Blanche, à Paris, faisant treize blessés ; le 17 octobre, l’explosion d’une bombe dans une rame du RER C, faisant vingt-neuf blessés. La vague d’attentats terroristes ayant visé la France a causé la mort de huit personnes et a fait cent quatre-vingt-dix-huit blessés. Le 29 septembre 1995, Khaled Kelkal a été abattu par les forces de sécurité françaises, emportant avec lui une partie des secrets de ces attentats. Quant à son émir Ali Touchent dit « Tarek », il a réussi à passer à travers les mailles du filet. Sa mort a été annoncée par un communiqué des services de sécurité algériens, en mai 1997. Mais qui pourrait vérifier la véracité de cette annonce ? L’homme, envoyé par l’émir du GIA version DRS serait un agent double travaillant aussi pour la Direction de la Sûreté du Territoire (DST), d’après le témoignage de son frère . Repéré en Belgique et en France, entre 1993 et 1995, Ali Touchent a échappé au moins à trois rafles de police. Il avait apparemment le flair d’un James Bond, mais il n’a pas pour autant sauvé ses proches et ses complices. Et pourtant, l’homme qui a toujours préféré voyager par container entre le port d’Alger et le port de Marseille ne se cachait absolument pas en Algérie. Il habitait même un luxueux appartement dans une cité gouvernementale du côté de Châteauneuf (proche de la fameuse caserne dont le parc regorgerait de corps de disparus selon la rumeur algéroise). Pour un émir recherché, il vivait tranquillement jusqu’au fameux procès du GIA, en novembre 1997, où il a été impliqué de manière directe. Plusieurs accusés l’ont désigné comme un élément des services de sécurité algériens qui avaient infiltré le GIA : « Pour moi, Tarek est un mec de la Sécurité Militaire algérienne qui se servait de nous », comme l’explique un témoin.
In Scènes d’horreur d’Alger à Paris (p 164 à 167)
Combien sont les disparus ? C’est la question à laquelle le pouvoir ne veut pas donner de réponse. Le chiffre des personnes disparues lors de la dernière décennie oscille entre dix mille et vingt mille selon les estimations de différentes ONG et des défenseurs des droits de l’homme. La majeure partie est le fait des services de sécurité. D’autres personnes ont été enlevées par les groupes islamistes armés pour soutenir le régime en place. Les premiers cas de disparition – des militants islamistes – ont été enregistrés juste après le putsch de janvier 1992. Cette pratique prendra de l’ampleur pour atteindre des pics effroyables entre 1995 et 1996, où des milliers de cas de disparus seront signalés. Au début du conflit armé, les dirigeants d’Alger avaient essayé de nier l’existence de telles pratiques, ou de les minimiser en évoquant des « cas isolés » ou en prétextant qu’il s’agissait de militants islamistes qui avaient rejoint les groupes armés ou avaient été enlevés par ces derniers.
La plupart des personnes disparues ont été enlevées par les forces de sécurité en pleine nuit. Toutefois des cas de disparition ont été signalés suite à des arrestations effectuées pendant la journée, soit sur les lieux de travail, soit près des centres universitaires, ou parfois en pleine rue. La tranche d’âge la plus touchée est celle des vingt-trente ans, mais des enlèvements d’adolescents et de vieillards ont été signalés. Selon l’association Algéria-Watch, l’âge des personnes enlevées va de 14 à 79 ans. Le niveau intellectuel de ces personnes est acceptable, loin des théories véhiculées par la presse proche du pouvoir ou par certains de ses porte-voix, les faisant passer pour des pouilleux, des gueux, des ignares : ainsi, on trouve des cadres, des médecins, des universitaires, des journalistes, des chefs d’entreprise, des commerçants, des étudiants… Les services de sécurité utilisaient souvent des voitures banalisées, de fausses cartes de police, de fausses plaques d’immatriculation, et les kidnappeurs étaient souvent déguisés et maquillés, portant de fausses moustaches, de fausses barbes. Ils arrivaient en enfonçant les portes, armes au poing, jamais identifiables. Selon le droit algérien, un suspect peut rester en garde à vue quarante-huit heures, délai au bout duquel il doit être présenté par l’officier de police judiciaire au Procureur de la République. Ce délai peut atteindre douze jours dans le cas de crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, sans la possibilité de voir un avocat, ce qui est contraire au droit international. Théoriquement, ce dernier permet à un détenu de bénéficier d’une visite médicale ou de communiquer avec sa famille. Mais la réalité est tout autre : les détenus suspectés d’appartenir à un groupe islamiste armé ou à l’un de ses réseaux de soutien, suspectés d’être membres de la famille d’un terroriste, ou d’être des militants actifs, étaient arrêtés, détenus dans des endroits souvent secrets, torturés, et une fois l’information recherchée obtenue, exécutés et enterrés dans des fosses communes. La durée de la détention pouvait varier de quelques jours à plusieurs années. Les familles, souvent démunies devant de telles situations, ne recevaient aucune information de la part des tortionnaires, elles étaient confrontées à un mur de silence, sinon menacées. Parfois, elles parvenaient à localiser les leurs, au début, lorsque ceux-ci avaient été emmenés dans les locaux de leurs tortionnaires, avant d’être torturés et de disparaître. L’information parvenait souvent de personnes arrêtées pour divers délits, puis relâchées.
Les Généraux d’Alger, qui ont fait la sourde oreille pendant des années, ont fini par reconnaître l’évidence devant l’ampleur du phénomène, les témoignages multiples de parents des victimes, de transfuges de l’armée, des différentes associations nationales et internationales. Cependant, si le nombre de disparitions a fortement diminué les trois dernières années, celles-ci persistent. Dans son édition du 8 janvier 2003, le journal Le Monde a révélé qu’un certain Kamel Boudahri, arrêté le 13 novembre 2002 à Mostaganem par les services de sécurité, était porté disparu. Le droit n’est toujours pas respecté : les personnes suspectes arrêtées par les services de sécurité ne bénéficient d’aucun droit tant que les services de la DRS n’ont pas décidé de les remettre à la justice. Les personnes disparues restent introuvables. Selon Tigha Abdelkader, il n’y a pas de disparus parce que tous ont été exécutés par la DRS et enterrés dans des fosses communes. Il estime le nombre des exécutions, au seul CTRI (Centre Territorial de Recherche et d’Investigation) de Blida à 4 000 entre 1993 et 1997, et il existe six CTRI en Algérie. Dès 1998, des fosses communes sont découvertes dans les régions déchirées par la violence en particulier (Larbaa dans la Mitidja, Relizane dans l’Ouest…). Une partie de la presse dite privée, proche du pouvoir, déclare, grâce aux sources DRS autorisées, que ces cadavres sont ceux de victimes enlevées par les groupes islamistes armés. Mais aucune étude sérieuse ne sera faite pour identifier les corps. Souvent entassés dans des puits en état de décomposition avancée, ils sont récupérés de façon artisanale par les éléments de la Protection Civile. Aucune technique appropriée n’a été utilisée. Le pouvoir n’a fait appel ni aux anthropologues légistes, ni aux techniques d’extraction d’ADN, faute de volonté et de moyens.
Les familles de disparus en quête de vérité, seules dans un premier temps, sont devenues solidaires et organisées au sein d’associations, soutenues par des organisations nationales et internationales défendant les droits de l’homme et des personnalités politiques de l’opposition. Des manifestations ont été organisées régulièrement à Alger et dans d’autres villes de province, demandant, sans succès, justice et vérité. Certains parents ont été menacés, d’autres arrêtés, ou battus par les services de sécurité. Leurs doléances restent vaines ; elles ne peuvent rien contre la puissance des Généraux, la raison d’État et les équilibres au sommet du pouvoir. Fidèles à leurs traditions, les Généraux au pouvoir tentent d’éviter de rendre des comptes sur leurs pratiques et trouvent un moyen pour classer le dossier. Le dédommagement des familles de disparus est un des moyens que la junte compte utiliser pour acheter le silence de ceux qui risquent un jour de les envoyer à La Haye. Les familles, quant à elles, ne demandent qu’une chose, connaître la vérité pour pouvoir faire le deuil : « Ce qui est angoissant, c’est que nous ne savons pas s’il est mort ou vivant. » Ou encore : « Qu’ils me disent où est enterré mon fils, ainsi je pourrai aller pleurer sur sa tombe. »
In Les disparus (p 172 à 176) ;
Extraits de L’Algérie des généraux Lyès Laribi Max Milo éditions Mai 2007 252 pages - 18 euros Préfacé par Ghazi Hidouci
Médine est la deuxième ville sainte de l’islam.
Khaled Nezzar, Échec à une régression programmée, p. 148.
Hichem Aboud, op. cit., p. 94.
Ali Yahia Abdenour, Algérie, raisons et déraisons d’une guerre, L’Harmattan, 2000, p. 142.
Annuaire de l’Afrique du Nord (1992), p. 656.
Du 20 au 22 février 1995.
Libération du 6 octobre 2002.
Ibid.


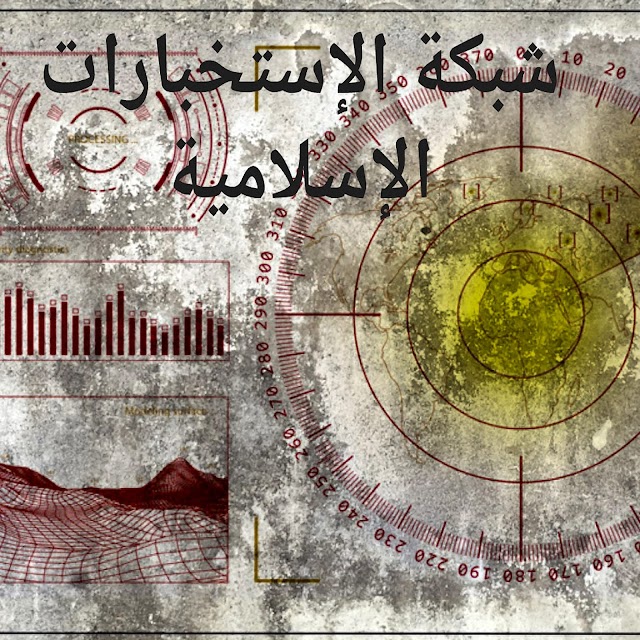


0 Comments