| Ahmed Simozrag | |
| Le 31 août 2009, les expulsés de Folembray ont passé quinze ans d’exil au Burkina Faso. Afin que nul n’ignore et que cet événement ne soit pas oublié, il m’a semblé opportun d’en relater le récit malgré le désagrément de parler de soi. 1— Rappel des faits Le 9 novembre 1993, la police française a déclenché une rafle dans les milieux « islamistes » en France. Dès cinq heures du matin, les forces de l’ordre investirent les sièges des associations islamiques et les domiciles de leurs dirigeants. Lorsque les policiers débarquent sur les lieux, agissant par groupe de cinq agents au minimum par domicile, ils commencent par neutraliser le chef de famille en le menottant ou en le mettant sous bonne garde, couper le téléphone et mener des perquisitions tous azimuts en passant au peigne fin tout ce qu’ils trouvent dans les lieux visités y compris dans les caves. Les perquisitions ont débouché sur la saisie d’une quantité importante de documents et de matériel informatique. Plusieurs associations ont été dépouillées de leur matériel et de leurs archives. Le matériel difficile à emporter comme les photocopieuses fut détruit sur place. Ladite rafle a donné lieu à l’arrestation de 88 personnes, qui furent conduites aux sièges des commissariats et de la préfecture de police de Paris pour interrogatoires et établissement d’un fichier anthropométrique. Les procès-verbaux d’enquête furent rédigés à la hâte sous l’inculpation sommaire d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Les prévenus furent brutalisés et contraints de signer les procès-verbaux contenant des déclarations approximatives peu conformes à leurs propos. D’aucuns ont refusé de signer. Après une garde à vue plus ou moins prolongée, l’opération s’est terminée par des expulsions, des mises en examen et des assignations à résidence. Je figure parmi les huit personnes assignées à résidence ce jour-là dans différents départements français. J’étais assigné à Florac en Lozère. Cette rafle a été suivie par une deuxième rafle effectuée début août 1994. Les personnes arrêtées au cours de cette rafle ainsi que les assignés de la première rafle ont été regroupés à la caserne Gaston Billote de Folembray. Celle-ci était entourée de barbelés et gardée par des dizaines de gendarmes lourdement armés. Ces derniers avaient l’air en colère, prêts à faire usage de leurs armes. Leurs collègues qui venaient de Paris pour emmener les interpellés nous ont avertis que les gendarmes en face sont en colère à cause de l’assassinat de leurs collègues à Alger. Les internés ne pouvaient pas sortir de la caserne. Nos menus achats étaient assurés par un coursier mis à notre disposition par la préfecture. Nous avions un poste de téléphone à la carte et un poste de télévision. Aucun parmi nous ne savait que nous allions être expulsés. Certains s’attendaient à un transfert, d’autres à un élargissement, d’autres n’avaient aucune idée de la suite qui les attendait. En revanche, bon nombre d’internés a exercé un recours et tous avaient l’espoir d’obtenir gain de cause. Malheureusement, cet espoir a volé en éclat lorsque, et contre toute attente, nous fumes surpris par ce qui peut être assimilé à un enlèvement. Le mercredi 31 août 1994, à cinq heures du matin, il s’est produit, pour reprendre les termes d’un frère, comme un tremblement de terre. Des centaines de policiers et de gendarmes ont pris d’assaut la caserne Gaston Billote. Ils défoncèrent les portes d’entrée et envahirent violemment les étages du bâtiment et la salle où les internés étaient en train de faire la prière. Devant leur attitude brutale et agressive, la prière fut interrompue. Un officier a sommé les internés de s’aligner face au mur signalant que le dispositif comptait cinq cent agents. D’autres scènes de violence se déroulaient aux étages supérieurs où un autre groupe d’une trentaine d’agents a défoncé les portes des chambres et arraché de leur sommeil les détenus qui s’y trouvaient. Certains agents violèrent l’intimité du couple Rassaf dont l’épouse était gravement malade. Ils ont pénétré violemment dans leur chambre et sans la moindre explication, ils ont passé les menottes au mari et ordonné à la femme de faire ses bagages. Les internés qui étaient en prière furent, chacun accompagné par deux policiers, conduits dans leurs chambres et sommés de faire leurs bagages. Pour ce faire, les policiers avaient des sacs « poubelle » et ils se mirent à ramasser eux-mêmes les effets afin d’accélérer l’opération. Entre temps, il a été procédé à une fouille au cours de laquelle les pièces d’identité furent retirées. Comme dans les rafles, aucun mandat de perquisition n’a été présenté. En revanche, des arrêtés d’expulsion furent notifiés mais les détenus ont refusé d’en signer les procès-verbaux du fait qu’ils n’avaient même pas le temps de prendre connaissance du contenu de ces arrêtés. Des protestations s’élevèrent concernant le droit d’informer les familles et les avocats, mais en vain. Cela leur a été refusé. Ils furent embarqués manu militari dans des minis bus banalisés. A l’intérieur des véhicules, chacun des internés était gardé par des agents qui en étaient spécialement chargé ; certains internés étaient menottés. Cinq internés furent séparés du reste et acheminés vers des destinations à l’intérieur de la France, pour y être assignés à résidence. Lorsque le convoi a quitté la caserne, on a pu constater l’important dispositif de sécurité mis en place tout le long du trajet. Le convoi arriva à l’aérogare de la base aérienne de Reims à 8h30 où un vol Charter de la Compagnie « European Airlins » (EAS) attendait. Madame Ressaf fut embarquée en premier par trois femmes policières suivies de son époux, menottes aux poings. Les détenus qui ont opposé une résistance furent embarqués de force dans l’avion. Certains furent roués de coups à même le sol, entraînés de force par les chaînes des menottes avant d’être portés et jetés un par un dans l’avion. A l’entrée de l’appareil, les expulsés étaient soumis à une fouille corporelle, exécutée par trois agents du RAID, chargés de la protection de la cabine du pilotage. Les expulsés étaient au nombre de vingt. Ils ignoraient complètement leur destination. Le décollage a eu lieu à 8h45 heures locale. Chaque détenu était assis au milieu de deux agents, collés à lui et qui l’accompagnaient même aux toilettes dont il devait laisser la porte ouverte. Ceux des détenus qui étaient sous traitement se sont vus refuser l’absorption de leurs médicaments. Le voyage a duré environ 8 heures 30 y compris les trois quarts d’heure d’escale aux îles Canaries pour le ravitaillement en carburant. Cette escale a permis de dissiper le doute sur la destination africaine des expulsés. Arrivés à Ouagadougou (Burkina Faso), les détenus ont chargé leurs délégués de s’enquérir de la situation administrative et sécuritaire avant de descendre de l’avion. La délégation fut reçue par le ministre chargé de mission à la Présidence et le directeur général de la Sûreté. Ces derniers ont donné des garanties suffisantes sur les conditions de sécurité et de séjour en attendant le procès. 2— Illégalité des mesures d’expulsion Hormis quatre demandeurs d’asile, les expulsés avaient tous des situations stables en France. Ils y étaient établis pendant des durées allant de dix à vingt-cinq ans. Ils possédaient des biens en France, y exerçaient des activités et y avaient des familles et des enfants français. De ce fait, ils sont inexpulsables tant au regard du droit français que du droit international. 2.1— Des accusations sommaires et sans preuves Il leur a été uniformément reproché de militer au sein d’un « mouvement qui prône le recours à la violence et au terrorisme, et ce par la collecte de fonds et la distribution de publications favorables à ce mouvement… » Ces accusations sont dénuées de tout fondement. Elles ont été vigoureusement démenties par les expulsés, qui déclarent ignorer le mouvement en question. Ils affirment que leurs rapports avec l’Algérie se limitent au besoin de s’informer des événements qui s’y déroulent. Ils estiment qu’il est absolument de leur droit de s’intéresser aux nouvelles de leur pays. Ils soutiennent qu’il est illégal et injuste de considérer comme une infraction, le fait de lire une publication ou un tract, d’assister à un meeting sur l’Algérie ou de suivre les événements qui secouent ce pays. En effet, ces accusations reposent sur des données inexactes établies à partir de fiches de renseignements « blancs » ne comportant ni en-tête, ni date, ni signature ; bref dépourvues de toute indication fiable. Elles s’inspirent des filatures, des écoutes téléphoniques et des ouï-dire où très souvent l’erreur ou le doute l’emportent sur la vérité et la certitude. Le ministre de l’Intérieur a reconnu implicitement l’absence de preuves, n’ayant agi que sur la base du doute à l’encontre des expulsés. Il a affirmé qu’il ne devrait pas « attendre que des bombes éclatent ou que des Français soient assassinés pour intervenir ! » Le ministre eut recours à la procédure dérogatoire de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, autorisant l’expulsion, sur la base de l’urgence absolue et/ou la nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, des étrangers protégés, sans qu’ils soient entendus par la commission spéciale d’expulsion. Cette procédure vise en principe les étrangers impliqués dans des faits graves d’espionnage ou de grand banditisme ou présentant une menace grave pour l’ordre public ou pour la sécurité du territoire. Ainsi, pour échapper aux conditions de la procédure normale prévues aux articles 23, 24 et 25 de l’ordonnance précitée, le ministre a commis un excès de pouvoir caractérisé à la fois par l’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, et le détournement de procédure en utilisant l’urgence absolue. En réalité, le recours à ladite procédure est infondé pour plusieurs raisons, notamment : 1— Le doute qui plane sur cette affaire à cause de l’absence de preuves. 2— Les personnes visées n'ont commis aucune infraction. Ils n’ont jamais fait l’objet de condamnations à de lourdes peines, ni à des peines légères. Ils n’ont jamais été impliqués dans des affaires d’espionnage, ni de terrorisme, ni de banditisme ou de trafic de drogues. Ils ne représentent aucune menace pour la sécurité du pays, étant donné que, tout au long de leur séjour en France, leur conduite n’a jamais été mise en cause. 3— Les expulsés résident en France depuis 10, 20 et 25 ans et ont des enfants français, et certains mariés à des Françaises. 4— L’absence de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par ailleurs, l’ancienne ministre Nicole Questiaux a précisé, lors de discussions parlementaires, que cette dérogation par rapport à la procédure normale ne concernerait que « le cas isolé de l'espion, de l'homme véritablement dangereux... » (1). 5— Les expulsés de Folembray font partie des catégories d’étrangers protégés. Le ministre de l’Intérieur a purement et simplement utilisé la procédure dérogatoire pour contourner l’interdiction de les expulser. 2.2— Atteintes aux droits de la défense Ces expulsions ont eu lieu à la veille d’une audience en référé qui devait se tenir jeudi 1er septembre au Tribunal de Laon. Elles furent exécutées au mépris des droits de la défense. « Le ministère de l’intérieur a sciemment soustrait les assignés à leurs juges, estime Me Jean-Daniel Dechezelles, qui défend dix-neuf des assignés aux côtés de Nathalie Creuzillet. Ils ne pourront pas comparaître physiquement à l’audience. On les prive volontairement d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Le ministère de l’Intérieur qui ne nous a pas prévenus de ces expulsions, fait volontairement abstraction du droit et de la justice. » (2) D’autre part, le Tribunal administratif de Paris était déjà saisi d’un recours en annulation des arrêtés d’assignation à résidence et d’expulsion me concernant. L’audience devait se dérouler le 9 décembre 1994, soit environ deux mois après la date d’expulsion. Ce fut donc une autre atteinte aux droits de la défense. Bien que cette procédure supprime la comparution devant la commission spéciale d'expulsion, elle ne dispense pas pour autant l’administration du contrôle du juge administratif. Il en résulte que l’utilisation abusive de cette procédure a porté gravement atteinte aux droits des expulsés. La précipitation avec laquelle s’est opérée l’expulsion n’a pas permis aux expulsés de se défendre ni même d’avertir leurs familles et leurs avocats. Or, dans cette affaire, encore une fois, il n’existe ni menace à l’ordre public, ni atteinte à la sûreté de l’Etat pour appliquer cette procédure. La loi n° 93.1027 du 24 août 1993 précise : « En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, l’expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ». Les conditions d’une urgence absolue et d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique n’étaient pas en l’espèce remplies. L’expulsion est une sanction extrêmement grave qui doit s’appliquer non seulement à des agissements particulièrement graves mais encore précis, circonstanciés et justifiés. Or, il n’en est rien. Les peines du bannissement et de la relégation ont été supprimées en raison de leur caractère inhumain. En tout état de cause, l’expulsion n’est pas moins inhumaine surtout lorsqu’elle touche une personne résidant en France depuis son enfance ou depuis quinze, vingt, ou vingt-cinq ans, elle est parfaitement assimilable à un bannissement, voire à une peine de mort différée, comme je l’ai dit à plusieurs occasions. Il est, en effet, insoutenable que des gens ayant vécu avec leurs familles en France depuis fort longtemps et dont le comportement et la moralité n’ont jamais été mis en cause, s’aventureraient subitement à porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat. Leur présence en France ne pouvait et ne peut en aucun cas troubler l’ordre public. Si tel était le cas, ils auraient fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions compétentes. Il importe de rappeler que le ministre de l’Intérieur a déjà pris des décisions de ce genre qui ont encouru l’annulation. Dans ce sens, il a déjà été jugé : « En refusant d’apporter la moindre preuve qu’un étranger était le responsable d’un parti islamique clandestin appelant à la guerre sainte, le ministre de l’Intérieur n’établit pas que l’expulsion de l’intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat. » (3) Aussi : « Considérant que pour ordonner l’expulsion de M… en application du deuxième alinéa de l’article 26 précité, le ministre de l’Intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé serait ‘‘l’homme de confiance des principaux responsables en France d’un mouvement qui prône le recours à la violence et au terrorisme auquel il apporte par ailleurs un soutien logistique sous forme de collecte de fonds et de distributions de publications favorables aux thèses intégristes et à l’action armée’’ ; que toutefois, les pièces produites par le ministre n’établissent pas la réalité des faits ainsi allégués et contestés par le requérant ; qu’ainsi, les conditions posées par l’article 26 précité de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas remplies ; qu’il suit de là qu’il ya lieu d’annuler l’arrêté en date du 10 août 1994 par lequel le ministre de l’Intérieur a enjoint à M… de quitter le territoire français. » (4) Ou encore : « Le ministre de l’Intérieur n’apporte ni faits, ni précisions, ni preuves, en alléguant que l’intéressé apporte un soutien logistique actif à un groupe d’actions violentes… » (5) Ou encore : « L’expulsion ne peut être regardée comme présentant un caractère d’urgence absolue, lorsque le ministre d’l’Intérieur, qui s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était ‘‘l’un des responsable d’un mouvement qui recourt à la violence et au terrorisme et qui est implanté sur le territoire français et dans divers Etats étrangers tant par des actions de collecte et de soutien financier que par des actions de propagande et de recrutement’’, n’a apporté, ni en première instance ni en appel devant le Conseil d’Etat, aucune précision sur les faits ainsi allégués qui permettent d’établir des liens de M. Kisa avec des activités terroristes. » (6) A ceux qui s’interrogent pourquoi pareille jurisprudence ne s’est-elle pas appliquée à notre cas, nous répondons que la plupart des expulsés ont renoncé à leurs droits en France y compris le droit d’ester en justice, préférant s’établir là où les droits humains sont mieux respectés. Quant à ceux, peu nombreux, qui ont exercé un recours, celui-ci n’a pas abouti à un certain niveau du fait que l’éloignement ne leur a pas permis de se défendre personnellement ni de se rapprocher physiquement de leurs avocats pour fournir davantage de preuves et de justifications sur leur innocence. 2.3— Atteintes à la vie privée et familiale Le respect de la vie privée et familiale est un des principes fondamentaux des droits de l’homme. Ce principe est prévu dans de nombreux instruments internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l’homme (art 8), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art 17) et la Déclaration universelle des droits de l’homme (art 12). L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la société publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre… » Plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ont invoqué le contenu de cette disposition pour interdire l'expulsion d'étrangers résidents de longue date. Ainsi, en est-il de sa décision du 26 mars 1992 condamnant la France pour violation de l’article 8 (7). Selon les termes de la Cour européenne des droits de l’homme, les expulsions constituent « une ingérence disproportionnée » dans l’exercice du droit à la vie privée. Inutile de rappeler le caractère éminemment sacré de la vie familiale. Or, toute ingérence doit être justifiée au préalable. Il est absolument absurde et illégal de bousculer la vie de plusieurs familles en France sur la base d’accusations gratuites et infondées. C’est pourquoi, la Cour européenne des droits de l’homme a entrepris de sanctionner les ingérences disproportionnées dans l’exercice de ce droit, même si les sanctions sont légales et légitimes (8). Aussi, a-t-il été jugé par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Belgacem du 19 avril 1991, que l'administration ne peut expulser un étranger que si l'atteinte portée à sa vie familiale n'est pas excessive par rapport aux nécessités de la défense de l'ordre public (9). Le Conseil d’Etat a également annulé, pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, un arrêté d’expulsion pris à l’encontre d’un ressortissant marocain n’ayant plus aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité (10). Il y a des cas où le Conseil d’Etat, « pour déceler une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale d’un étranger » met en avant l’ancienneté du séjour de l’intéressé « qui réside en France depuis 1990 et ses attaches familiales. Père de trois enfants français, il exerce sur eux l'autorité parentale et pourvoit à leur entretien. » (11) Les expulsés ont été privés du respect de leur vie privée et familiale garanti par les textes susmentionnés. A la date de leur expulsion, les intéressés avaient laissé derrière eux quarante enfants mineurs sans soutien et sans ressources. L’expulsion de leurs pères les a privés des moyens de subsistance et bouleversé leur scolarité. De nombreux enfants ont subi un échec scolaire en raison du traumatisme psychique et du manque de soutien engendrés par l’absence de leurs pères. A cet égard, il convient de souligner que certains enfants se sont trouvés livrés à eux-mêmes depuis l’expulsion de leurs pères, d’autres ont été expulsés du logement fautes de payement des loyers et ils furent jetés à la rue, d’autres encore sont tombés malades sans pouvoir bénéficier des soins nécessaires à cause des problèmes de sécurité sociale liés à l’éloignement de leurs pères, etc., etc. Rappelons également quatre cas de divorce engendrés par l’expulsion. Pourtant, l’enfant a des droits légalement protégés. Parmi les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, figure l’obligation de veiller à ce que l’enfant ne soit pas privé de son milieu familial, ni séparé de ses parents. La Convention exhorte ces derniers, sous la responsabilité des Etats bien entendu, à assurer les conditions de vie nécessaires à l’éducation et au développement de l’enfant. L’article 16 de la dite convention prévoit : « Nul enfant ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » L’expulsion du père est un acte de nature à porter gravement atteinte aux droits de l’enfant. 3— Justice et raison d’Etat : un combat éternel La raison d’Etat est une forme d’arbitraire qui se dresse sans cesse contre la justice et les droits de l’homme. Même les modèles d’Etats de droit les plus achevés n’échappent pas à cette tentation. D’où, à mon avis, la nécessité de renforcer et l’indépendance de la justice et le contrôle judiciaire des décisions de l’administration. La loi française prévoit la possibilité que l’expulsion soit levée après un délai de cinq ans (12). Le bannissement lui-même, en supposant que ce soit le cas, est limité à une durée maximale de dix ans (13). Après cinq ans d’exil, le 6 septembre 1999, nous avions saisi le ministre, sous le couvert de l’Ambassadeur de France au Burkina Faso, d’une demande d’abrogation rappelant que les arrêtés d’expulsion avaient été exécutés depuis plus de cinq ans et que nous souhaiterions retrouver nos familles en France. Cette demande est demeurée sans suite jusqu’à nos jours. En effet, le refus d’abroger un arrêté d’expulsion ne peut être légalement fondé que si la présence de l’étranger constitue encore une menace grave pour l’ordre public, après un examen particulier des circonstances de l’espèce (14). Le Conseil d’Etat a notamment annulé des refus d’abrogation d’arrêté d’expulsion pour atteinte excessive à la vie familiale : — pour un étranger qui, bien qu’ayant commis des infractions graves lui ayant valu une condamnation à 15 ans de réclusion pour vol avec arme, violence et tentative d’homicide, a en France l’ensemble de sa famille proche, dont certains membres ont la nationalité française, et est marié à une personne de nationalité française dont il a un enfant (15) ; — pour un étranger dont l’arrêté d’expulsion, assorti d’une assignation à résidence, était motivé par des faits ayant entraîné des condamnations pénales de six mois, deux ans et quatre ans d’emprisonnement, et avait récidivé pendant son assignation à résidence, mais s’était ensuite marié à une française (16). Deux expulsés ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’abrogation des arrêtés ministériels d’expulsion pris à leur encontre. Le juge administratif a ordonné l’abrogation de leurs arrêtés d’expulsion, ce qui a été fait. Mais le visa pour retourner en France ne leur a pas été accordé. De tels faits, opposant l’administration à la justice, sont fréquents de sorte que plusieurs fois le juge des référés, gardien des libertés individuelles, intervienne pour la délivrance du visa. Il semble que les autorités consulaires ne sont pas nécessairement tenues de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France. Selon un arrêt du Conseil d’Etat, elles peuvent refuser le visa à un étranger dont l’arrêté d’expulsion a été annulé pour atteinte au respect de la vie privée et familiale et « dont la situation de fait n’a pas évolué depuis la mise à exécution de l’arrêté » (17). Il faudrait donc attendre la Cour européenne des droits de l’homme pour établir une jurisprudence constante dans ce domaine. Ahmed Simozrag 26 octobre 2009 Références (1) Débat Assemblée Nationale du 30 septembre 1981. (2) Le Monde du 2 septembre 1994. (3) Tribunal Administratif Limoges, 9 avril 1993, JCP IX, n° 909, p. 103. (4) Tribunal Administratif de Versailles, 6 décembre 1994. (5) Conseil d’Etat, GP 1990. 2 Som. 553. (6) CE, 1 avril 1998, Kisa, req n° 163901. (7) Arrêt Beldjoudi c/ France du 26 mars 1992. (8) CEDH, 29 juin 1988, Berrahab c/Pays-Bas, Série A. Vol.1238 RTDE 1989 n°2 p. 153. (9) CE, Ass., 19 avril 1991 Belgacem et Babas, 2 arrêts Rec. Leb. 151 et 163 Concl. M.R. Abraham, RFDA 1991. 497 et s. (10) CE, 8 juillet 1996, Gargari, req n° 138127 et 139883. (11) CE, 23 avril 2009, req. n° 297638, Aguemon. (12) Article 23 de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. (13) Ordonnance N°60-529 du 4 juin 1960. (14) CE, 16 mars 1984, Min de l’Int c/ Djaballah, Rec p 115 ; 19 novembre 1990, Raso, Rec tables p 775 1JDA 1991 p 325. (15) CE, 10 avril 1994, Benamar, req n° 127691. (16) CE, 22 juin 1994, Amamra, req n° 148185. (17) CE, 26 janvier 2009, req n° 310469, M. Ahmed A. http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=64 |
Terrorisme d'Etats: La France condamnée a payer
Abu-Suleyman
11:01 AM
Expulsés de Folembray : la force, le droit et la justice
Translate It!
ISLAMIC INTELLIGENCE NETWORKS (IIN)
"They plot and plan but ALLAH also plans and ALLAH is the best of Planners." Qur’an VIII – 30
‘’ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ‘’: قال الله عزَّ وجل
سورة الأنفال
رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا رسولا لا إلـه إلا اللـه ... محمد رسـول اللـه
ISRAEL'S #NUCLEAR911 IS ON
Labels
- #FAMED #EUMADF 2
- #FAMED #EUMADF #nuclear911 #blackjack_Litvinenko #catastrophe #cyber911 #collapse #FreePalestine 2
- #SpaceXEMP #FortressAmericas #GazaGenocide 1
- #SpaceXEMP #FortressAmericas #GazaGenocide #LEbanon #Syria 1
- 7/7 an israeli job 4
- 9/11 1
- Afghanistan 58
- Africa 6
- Afrique 2
- Al Aqsa 2
- Al Aqsa under siege 13
- Al Quds 13
- Algeria 9
- Algerie occupée 3
- Ambassadeur du terrorisme israelien en France 5
- Analyse 3
- Analyses 3
- Analyses: Revolutions Arabes 4
- Analysis 2
- Antichrist is in Israel 5
- Arabian Sea 1
- Arabie Saoudite 1
- Asia 1
- Bahrain 3
- Biological warfare 6
- Bioterrorism 4
- Biowarfare 2
- Blitzkrieg on the Middle East 1
- Blocus de la bande de Gaza 5
- Bosnia 1
- Bosnie 1
- Brown the mossad asset 4
- Call to Jihad 1
- Caspian region 1
- Caucase 1
- Caucasus 1
- Censure 1
- Chechnya 1
- China 4
- choc des civilisations en Europe 1
- Climate change is a myth 1
- Collapse of Europ 2
- Collapse of Europe 2
- Comments 1
- Communiqué 2
- Cote D'Ivoire 3
- Coup de gueule 1
- crise economique 1
- Croisade contre L'Islam 2
- Crusade against Muslims 2
- Daguestan 1
- DAWAH 1
- Debacle sioniste en Iraq 4
- DEGAGEZ 1
- Dubai 1
- Economie 18
- Economy 18
- Economy : Destruction of the US dollars by the zionists 7
- Egypt 16
- Eid Mubarak 2
- End of Israel 8
- Eretz Yisrael 2
- Ethiopia 1
- Euramerica Reich 2
- Euro-Reich 2
- europe dominée 2
- Europe occupée 3
- Expulsion de la France-Israel du Maghreb-Sahel 2
- False Falg Operations 2
- False flag in Sweden 1
- False Flag Operations 4
- Fin d'israel 4
- Fondations de l'Etat Islamique 1
- France-Israel 26
- France-Israel au Maghreb 24
- France-Israel au Maghreb-Sahel 12
- France-Israel en Afrique 7
- France-Israel en Algerie 50
- France-Israel in Algeria 2
- France-Israel-Algerie 4
- France-Israel's False Flag Terrorism 1
- Gaza 2
- GAZA LIVE 2
- Genocid in Gaza 2
- Genocide de la bande de Gaza 58
- Genocide de la Palestine 35
- Genocide francais au Rwanda 1
- Genocide francais en Algerie 25
- Genocide in #Palestine 1
- Genocide in Gaza 37
- Genocide in Iraq 13
- Genocide in Myanmar/Burma 3
- Genocide in Palestine 18
- Genocide of the Palestine 1
- Genocides de la France en Afrique 3
- Genocides de la France-Israel 2
- geopolitics 2
- Georgie-Ossetie du Sud 2
- Germany 1
- Germany involved in the set up of the new 9/11 2
- GGenocide de la Palestine 1
- Global warming is a scam 1
- GOLD DINAR SILVER DIRHAM 1
- Grande Bretagne occupee 5
- Great Britain occupied 14
- Guantanamo 8
- Guerre civile en France 11
- GUERRE CIVILE VOULUE PAR LE CRIF EN FRANCE 33
- Guerres civiles en occident 1
- Haiti 1
- Health 1
- Histoire 1
- History 1
- Hommage 1
- India 3
- Indonesia 1
- Internet 1
- Interview 1
- Ira 1
- Iran 40
- Iraq 5
- Iraq occupe 6
- Iraq occupied 1
- ISLAAM 54
- Islamic Poetry 1
- Islamophobia 3
- Islamophobia in the US 2
- Islamophobie 1
- ISRAEL 1
- israel and the 'Arab Spring' 4
- Israel and the new 9/11 34
- israel and the next 9/11 30
- Israel and the next 9/11 11
- israel and the next 911 7
- Israel behind civil wars in Europe 4
- Israel behind civil wars in the West 5
- Israel controls america 5
- Israel Crusade against Muslims 2
- Israel crusades against Islaam 3
- Israel did 7/7 1
- ISRAEL DID 9/11 76
- Israel et la guerre civile au Moyen Orient 1
- Israel et la guerre civile en Europe 1
- Israel false flag terrorism 8
- israel finance l'islamophobie 2
- Israel finance l'islamophobie en France 1
- ISRAEL IS BEHIND 9/11 48
- ISRAEL IS BEHIND 911 9
- Israel is manufacturing the the civil wars in Europe 1
- ISRAEL IS THE MODEL OF THE NEW TOTALITARIAN WESTERN NAZISM 1
- Israel new 9/11 in Europe 1
- Israel prepares a new 9/11 in Europe 1
- Israel TAPI pipeline in Afghanistan 1
- Israel's #nuclear911 is on 1
- ISRAEL'S FALSE FLAG TERRORISM 2
- ISRAELI FALSE FLAG TERRORISM 53
- ISRAELI FLASE FLAG 3
- ISRAELI FLASE FLAGS 1
- Israeli mafia 1
- Israeli terrorist networks in the US 2
- Japan 1
- Jerusalem in the Quran 1
- Jihad 1
- Karachi Gate 6
- Kashmir 1
- Kataeb Azzedine Al Qassam 1
- Khilafa is back 3
- Koweit Gate 1
- Kuweit 1
- Kyrgyzstan 1
- Latin America 1
- Lebanon 6
- Liban 5
- Libya 61
- Libyan 1
- Libye 10
- London Olympics false flag 1
- Lybia 5
- Maghreb occupé 2
- Maghreb-Sahel 2
- Magnetic reversal 1
- Mali 8
- Manipulation gouvernementale 1
- Maroc 2
- Mauritanie 1
- Media 2
- Middle East 4
- Mossad bombs chruch in Iraq 1
- nato terrorism 1
- Nazi Israel 1
- Nazification of the USA by the AIPAC 1
- Netanyahu controls US wars in the Middle East 4
- NGO and intelligence services 1
- Niger 3
- Nigeria 3
- North Africa 2
- North Korea 2
- Norway 7
- Obama Premier 1
- occupied by french nazis zionist 1
- occupied palestine 4
- Opinion 1
- Pakistan 15
- Palestine 28
- Palestine Occupee 36
- Palestine occupée 1
- Pax Talmudica 2012 1
- Pax Talmudica 2012: To rule the world from the Temple Mount 7
- Pax Talmudica/Nouvel Ordre Mondial 5
- Petrol 1
- Poeme 1
- Politique 1
- Propaganda 1
- Purification ethnique de la Palestine 1
- Qatar 3
- Quatrieme guerre mondiale 7
- Racaille sioniste 2
- Racisme israelien en France 1
- Ramadhan 1
- rendition 1
- Resistance Islamique 6
- Revoltes au Maghreb 7
- Revolution dans le monde Musulman 34
- Revolution en France 1
- Revolutions Arabes 4
- Russia 7
- Sahel 2
- Sahel occupé 5
- Sarkosy 3
- Sarkosy : Ambassadeur du terrorisme israelien en France 14
- Sarkosy :Ambassadeur du terrorisme israelien en France 65
- Sarkosy ministre du terrorisme israelien 48
- SARKOZY 1
- Sarkozy ben Mossad 3
- Saudi Arabia Occupied 11
- Sauid Arabia Occupied 1
- Somalia 5
- Soudan 1
- Squarcini l'ane du mossad en France 2
- Sri Lanka 1
- State Terrorism 2
- strategie 1
- Syria 28
- Syrie 3
- Terrorisme d'Etat 4
- Terrorisme Francais 22
- Terrorisme français 19
- Terrorisme Francais en Algerie 107
- Terrorisme Francais en Arabie Saoudite 1
- Terrorisme Israelien 146
- Terrorisme Sioniste 168
- Terrorisme Sioniste au Maghreb 3
- Terrorisme Sioniste au Soudan 1
- Torture 1
- Tribune libre 1
- Truth Jihad 1
- Tunisia 1
- Tunisie 1
- Tunisie encore occupée 13
- Turkey 8
- Turquie 4
- UAE 1
- USA occupes 4
- USA occupied 26
- Vague d'attentats en France 1
- Venezuela 1
- VIDEO 8
- War in the Maghreb-Sahel 1
- WAR ON IRAN 3
- war on Islaam 9
- War on Islaam in the EU 4
- War on Islaam in the UK 13
- War on Islaam in the US 5
- War on Islaam in UK 7
- WAR ON PAKISTAN 35
- War on Sudan 1
- War world III 1
- World War IV 9
- Xinjuang province 1
- Yemen 7
- Zionism control of the West 3
- Zionism Deception 16
- Zionism defeated by Islaam 1
- Zionism in the medias 2
- Zionism Racism 2
- Zionist deception 26
- Zionist Egypt 8
- Zionist fiasco in Iraq 6
- zionist Great Britain 2
- zionist terrorism 17
- Zionist Wikileaks 1
- Zionists deception 15
Featured Post
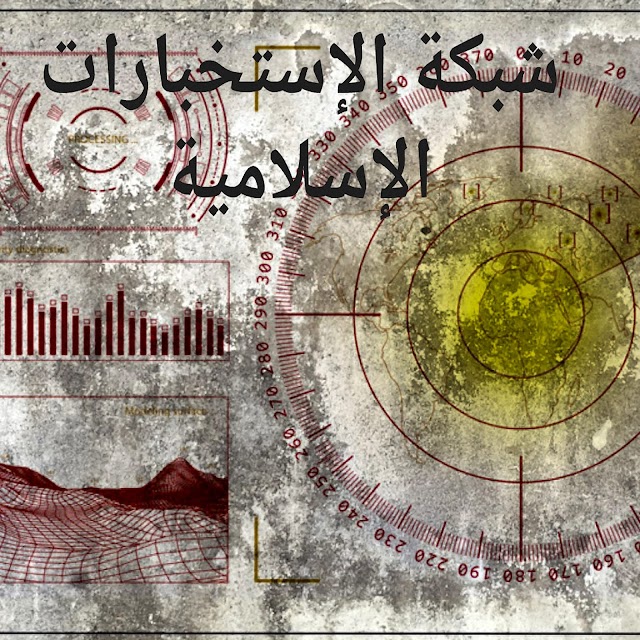
PAX TALMUDICA: GUEOULA DEPUIS TSARFAT/GUELA FROM SARFAT/PARIS/FRANCE: TALMUDIC ARMAGEDDON IS LAUNCHED FROM PARIS TO START THE NEW TALMUDIC ORDER OF TOTAL CHAOS ON EARTH. NETANYAHU THREATENS TO GENOCIDE MUSLIMS IN FRANCE, EUROPE, WEST, PALESTINE
Abu-Suleyman
8:23 AM
#GUEOULA DEPUIS TSARFAT/GUELA FROM SARFAT: LES DERNIERES MISES A JOURS SONT PLUS B…
IIN
"They plot and plan but ALLAH also plans and ALLAH is the best of Planners." Qur’an VIII – 30
: قال الله عزَّ وجل
‘’ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ‘’
سورة الأنفال
رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا رسولا
لا إلـه إلا اللـه ... محمد رسـول اللـه
LINKS - LIENS INTERESSANTS
- Afghanistan
- Afghanistan Resistance daily operations (arabic)
- Africa News Analysis
- AL AQSA ON LINE
- Al Aqsa TV (Palestine)
- AL AQSA VOICE
- Al Nass TV (Qanat-Al Nass)
- AL Qassam Brigades website
- Al Quds in the Quran (Jerusalem in the Quran)
- Al Quds TV (Arabic)
- Al Rahma TV
- Al Rissala TV (Arabic)
- Alhiwar TV
- All Islamic TV and Radio
- AlMajd TV
- Alter Info
- Anasheed/Iraq Nasheed
- ANTI PROPAGANDE
- BOLLYN : SOLVING 9-11: THE BOOK
- CAGE PRISONERS
- Chronique de Guantanamo
- CLEARSTREAM : SARKOSYGATE
- CRIMES OF ZION : ISRAEL AND 911
- Daily operations of the Islamic Resitance in Iraq
- France-Iraq : Le blog de Gilles Munier
- FREE GAZA : THE 'SEA LIFT'
- Genocide de la France au Rwanda
- Iqraa TV
- Iraq (Rapports de la Resistance)
- ISLAAM TO ALL
- ISLAM TV FRANCE
- ISLAMICTUBE
- Islammemo
- Israel did 9/11
- JIHAD : IRAQI RESISTANCE OPERATIONS
- LA FIN DE SION
- Les dessous de l’actualité mondiale
- Maping the israeli terrorist network in the USA
- Modern Islamic Studies
- MUSLIM INDIA
- Muslim Prisoners Files
- NASHEED DJIHAD
- NAZI ISRAEL
- News d'Afrique
- Pakistan
- Palestine Info
- Palestine Tube
- QURAN EXPLORER
- Quran Recitation
- QURAN TV
- Scandale du Koweit Gate
- Tchetchenie : Kavkazcenter
- THE MASK OF ZION
- WAKE UP PROJECT
- ZionoFascism : The real face of Zionism
POSTS ARCHIVED
Tags
- #FAMED #EUMADF 2
- #FAMED #EUMADF #nuclear911 #blackjack_Litvinenko #catastrophe #cyber911 #collapse #FreePalestine 2
- #SpaceXEMP #FortressAmericas #GazaGenocide 1
- #SpaceXEMP #FortressAmericas #GazaGenocide #LEbanon #Syria 1
- 7/7 an israeli job 4
- 9/11 1
- Afghanistan 58
- Africa 6
- Afrique 2
- Al Aqsa 2
- Al Aqsa under siege 13
- Al Quds 13
- Algeria 9
- Algerie occupée 3
- Ambassadeur du terrorisme israelien en France 5
- Analyse 3
- Analyses 3
- Analyses: Revolutions Arabes 4
- Analysis 2
- Antichrist is in Israel 5
- Arabian Sea 1
- Arabie Saoudite 1
- Asia 1
- Bahrain 3
- Biological warfare 6
- Bioterrorism 4
- Biowarfare 2
- Blitzkrieg on the Middle East 1
- Blocus de la bande de Gaza 5
- Bosnia 1
- Bosnie 1
- Brown the mossad asset 4
- Call to Jihad 1
- Caspian region 1
- Caucase 1
- Caucasus 1
- Censure 1
- Chechnya 1
- China 4
- choc des civilisations en Europe 1
- Climate change is a myth 1
- Collapse of Europ 2
- Collapse of Europe 2
- Comments 1
- Communiqué 2
- Cote D'Ivoire 3
- Coup de gueule 1
- crise economique 1
- Croisade contre L'Islam 2
- Crusade against Muslims 2
- Daguestan 1
- DAWAH 1
- Debacle sioniste en Iraq 4
- DEGAGEZ 1
- Dubai 1
- Economie 18
- Economy 18
- Economy : Destruction of the US dollars by the zionists 7
- Egypt 16
- Eid Mubarak 2
- End of Israel 8
- Eretz Yisrael 2
- Ethiopia 1
- Euramerica Reich 2
- Euro-Reich 2
- europe dominée 2
- Europe occupée 3
- Expulsion de la France-Israel du Maghreb-Sahel 2
- False Falg Operations 2
- False flag in Sweden 1
- False Flag Operations 4
- Fin d'israel 4
- Fondations de l'Etat Islamique 1
- France-Israel 26
- France-Israel au Maghreb 24
- France-Israel au Maghreb-Sahel 12
- France-Israel en Afrique 7
- France-Israel en Algerie 50
- France-Israel in Algeria 2
- France-Israel-Algerie 4
- France-Israel's False Flag Terrorism 1
- Gaza 2
- GAZA LIVE 2
- Genocid in Gaza 2
- Genocide de la bande de Gaza 58
- Genocide de la Palestine 35
- Genocide francais au Rwanda 1
- Genocide francais en Algerie 25
- Genocide in #Palestine 1
- Genocide in Gaza 37
- Genocide in Iraq 13
- Genocide in Myanmar/Burma 3
- Genocide in Palestine 18
- Genocide of the Palestine 1
- Genocides de la France en Afrique 3
- Genocides de la France-Israel 2
- geopolitics 2
- Georgie-Ossetie du Sud 2
- Germany 1
- Germany involved in the set up of the new 9/11 2
- GGenocide de la Palestine 1
- Global warming is a scam 1
- GOLD DINAR SILVER DIRHAM 1
- Grande Bretagne occupee 5
- Great Britain occupied 14
- Guantanamo 8
- Guerre civile en France 11
- GUERRE CIVILE VOULUE PAR LE CRIF EN FRANCE 33
- Guerres civiles en occident 1
- Haiti 1
- Health 1
- Histoire 1
- History 1
- Hommage 1
- India 3
- Indonesia 1
- Internet 1
- Interview 1
- Ira 1
- Iran 40
- Iraq 5
- Iraq occupe 6
- Iraq occupied 1
- ISLAAM 54
- Islamic Poetry 1
- Islamophobia 3
- Islamophobia in the US 2
- Islamophobie 1
- ISRAEL 1
- israel and the 'Arab Spring' 4
- Israel and the new 9/11 34
- israel and the next 9/11 30
- Israel and the next 9/11 11
- israel and the next 911 7
- Israel behind civil wars in Europe 4
- Israel behind civil wars in the West 5
- Israel controls america 5
- Israel Crusade against Muslims 2
- Israel crusades against Islaam 3
- Israel did 7/7 1
- ISRAEL DID 9/11 76
- Israel et la guerre civile au Moyen Orient 1
- Israel et la guerre civile en Europe 1
- Israel false flag terrorism 8
- israel finance l'islamophobie 2
- Israel finance l'islamophobie en France 1
- ISRAEL IS BEHIND 9/11 48
- ISRAEL IS BEHIND 911 9
- Israel is manufacturing the the civil wars in Europe 1
- ISRAEL IS THE MODEL OF THE NEW TOTALITARIAN WESTERN NAZISM 1
- Israel new 9/11 in Europe 1
- Israel prepares a new 9/11 in Europe 1
- Israel TAPI pipeline in Afghanistan 1
- Israel's #nuclear911 is on 1
- ISRAEL'S FALSE FLAG TERRORISM 2
- ISRAELI FALSE FLAG TERRORISM 53
- ISRAELI FLASE FLAG 3
- ISRAELI FLASE FLAGS 1
- Israeli mafia 1
- Israeli terrorist networks in the US 2
- Japan 1
- Jerusalem in the Quran 1
- Jihad 1
- Karachi Gate 6
- Kashmir 1
- Kataeb Azzedine Al Qassam 1
- Khilafa is back 3
- Koweit Gate 1
- Kuweit 1
- Kyrgyzstan 1
- Latin America 1
- Lebanon 6
- Liban 5
- Libya 61
- Libyan 1
- Libye 10
- London Olympics false flag 1
- Lybia 5
- Maghreb occupé 2
- Maghreb-Sahel 2
- Magnetic reversal 1
- Mali 8
- Manipulation gouvernementale 1
- Maroc 2
- Mauritanie 1
- Media 2
- Middle East 4
- Mossad bombs chruch in Iraq 1
- nato terrorism 1
- Nazi Israel 1
- Nazification of the USA by the AIPAC 1
- Netanyahu controls US wars in the Middle East 4
- NGO and intelligence services 1
- Niger 3
- Nigeria 3
- North Africa 2
- North Korea 2
- Norway 7
- Obama Premier 1
- occupied by french nazis zionist 1
- occupied palestine 4
- Opinion 1
- Pakistan 15
- Palestine 28
- Palestine Occupee 36
- Palestine occupée 1
- Pax Talmudica 2012 1
- Pax Talmudica 2012: To rule the world from the Temple Mount 7
- Pax Talmudica/Nouvel Ordre Mondial 5
- Petrol 1
- Poeme 1
- Politique 1
- Propaganda 1
- Purification ethnique de la Palestine 1
- Qatar 3
- Quatrieme guerre mondiale 7
- Racaille sioniste 2
- Racisme israelien en France 1
- Ramadhan 1
- rendition 1
- Resistance Islamique 6
- Revoltes au Maghreb 7
- Revolution dans le monde Musulman 34
- Revolution en France 1
- Revolutions Arabes 4
- Russia 7
- Sahel 2
- Sahel occupé 5
- Sarkosy 3
- Sarkosy : Ambassadeur du terrorisme israelien en France 14
- Sarkosy :Ambassadeur du terrorisme israelien en France 65
- Sarkosy ministre du terrorisme israelien 48
- SARKOZY 1
- Sarkozy ben Mossad 3
- Saudi Arabia Occupied 11
- Sauid Arabia Occupied 1
- Somalia 5
- Soudan 1
- Squarcini l'ane du mossad en France 2
- Sri Lanka 1
- State Terrorism 2
- strategie 1
- Syria 28
- Syrie 3
- Terrorisme d'Etat 4
- Terrorisme Francais 22
- Terrorisme français 19
- Terrorisme Francais en Algerie 107
- Terrorisme Francais en Arabie Saoudite 1
- Terrorisme Israelien 146
- Terrorisme Sioniste 168
- Terrorisme Sioniste au Maghreb 3
- Terrorisme Sioniste au Soudan 1
- Torture 1
- Tribune libre 1
- Truth Jihad 1
- Tunisia 1
- Tunisie 1
- Tunisie encore occupée 13
- Turkey 8
- Turquie 4
- UAE 1
- USA occupes 4
- USA occupied 26
- Vague d'attentats en France 1
- Venezuela 1
- VIDEO 8
- War in the Maghreb-Sahel 1
- WAR ON IRAN 3
- war on Islaam 9
- War on Islaam in the EU 4
- War on Islaam in the UK 13
- War on Islaam in the US 5
- War on Islaam in UK 7
- WAR ON PAKISTAN 35
- War on Sudan 1
- War world III 1
- World War IV 9
- Xinjuang province 1
- Yemen 7
- Zionism control of the West 3
- Zionism Deception 16
- Zionism defeated by Islaam 1
- Zionism in the medias 2
- Zionism Racism 2
- Zionist deception 26
- Zionist Egypt 8
- Zionist fiasco in Iraq 6
- zionist Great Britain 2
- zionist terrorism 17
- Zionist Wikileaks 1
- Zionists deception 15




0 Comments