"Les vrais mafieux lisent le Financial Time ou le Wall Street Journal"
Par Denis Robert, (son site)
Voilà ce qu’écrivait Denis Robert dans « une affaire personnelle » sorti en avril dernier...
Parmi les sociétés qui ont réalisé le plus de bénéfices en une trentaine d’années, on trouve d’abord des banques. La magazine Forbes a établi en 2007 le Hit Parade des sociétés mondiales cotées en Bourse. Les critères du palmarès étaient les bénéfices. On mesure ici la rentabilité et non le chiffre d’affaires qui n’indique que la masse. Les banques américaines se partagent les premières places du classement, avec en tête Citygroup, qui était déjà premier l’an dernier. Il arrive devant Bank of America, qui a gagné une place. La banque britannique HSBC se place en troisième position. Ces banques sont toutes clientes de la multinationale qui me fait des procès et ont eu un représentant à son conseil d’administration. Les banques américaines occupent six des sept premières places. BNP Paribas est le premier groupe français et se place en quatorzième position, loin devant les pétroliers comme Total ou l’assureur Axa.
Les banques sont le fleuron du capitalisme. Elles sont aussi les sociétés les plus incontrôlables. L’un ne va pas sans l’autre. Toutes ces banques arrivées en tête du hit parade de Forbes ont ouvert des milliers de comptes dans tous les paradis fiscaux de la planète. D’un côté, on vente leur sérieux et leur stratégie. D’un autre, on les laisse défiscaliser à tout va. Les journaux n’évoquent jamais ce double jeu. Les journaux ne parlent jamais de leur pouvoir, mais se lamentent sur leur sort en cas de faillite ou de krach. Les banques sont de très gros annonceurs. La plupart des médias appartiennent ou sont gérés par des pools bancaires. Les banques sont à l’origine et à la conclusion de tout ce qui fait la vie économique et financière de nos sociétés. Elles sont intouchables. Elles sont la façade légale et la porte d’entrée du crime organisé dans nos sociétés. Je me suis intéressé à elles parce que j’ai compris qu’elles étaient une des clés du système de contrôle et d’appauvrissement de nos sociétés.
La banque, l’argent ne lui coûte rien.
Elle le fabrique et le revend. Le cash c’est pour la galerie ou les distributeurs automatiques. 99 % des masses monétaires qui circulent par le monde sont virtuelles. Cette fausse monnaie est investie en actions et en obligations. Puis, pour une part considérable, cachée dans des paradis lointains. Seules les banques savent y aller. Elles peuvent y libérer leurs rapacités. La seule différence entre une banque et une autre réside en sa communication. L’image qu’elle donne au monde. En vitrine, elles minaudent. Dans l’arrière-cuisine, elles sortent les griffes et les couteaux.
Les banquiers se sont partagé la planète. Mais à force de tirer sur les bénéfices, le marché se réduit. Alors les banques se bouffent entre elles. C’est leur côté mante religieuse. Les batailles sont terribles en coulisse. BNP a croqué Paribas. Citygroup a dévoré la banque d’investissement de Shroders. Deutsche Bank et Dresdner Bank ont muté. HSBC a englouti le Crédit commercial de France. L’espagnole Banco Bilbao a digéré la Banca Nazionale del Lavoro italienne. La hollandaise ABN Amro s’est farcie la Banque populaire de Vénitie. Fortis a mangé la Banque générale de Luxembourg. Après avoir roté un bon coup, elles continuent leur business qui consiste souvent à piller les États. Et donc à faire les poches des habitants de ces États.
Les banques vendent aux gogos leur capacité à faire gagner de l’argent. Elles sont la cheville essentielle du piège qui s’est refermé sur nous. Derrière la vitrine et l’apparence de sérieux, elles participent au dynamitage de nos démocraties. Elles nous attirent et nous entubent à coup de publicités hypnotisantes. Envoyez-vous en l’air avec un pass auto à 3 %, réalisez votre rêve de Home sweet home avec un crédit immobilier à 4 %, allongez-vous sur un matelas vacances à 5 %.
Pourtant à la seconde où un citoyen remet à son banquier ce qui lui appartient, ces dépôts deviennent, par une loi mécanique, un emprunt pour la banque. Qu’est-ce qu’il vient de déposer sinon le fruit de son travail ou de son héritage ? Qu’est-ce que la banque vient d’encaisser sinon de l’argent qui ne lui appartient pas ? Le premier succès des banques et le fait qu’elles soient les entreprises les plus florissantes de la planète repose sur ce hiatus. En créant le monopole de la circulation de l’argent, puis en inventant sa dématérialisation, elles font passer pour un service à leurs clients ce qui est un devoir très rémunérateur pour elles.
Les banquiers se servent de nos économies pour spéculer sur les marchés et inventer, avec la complicité des traders et autres dealers, de nouveaux produits de plus en plus pointus. Des fonds alternatifs qui donnent la possibilité de vendre du temps et du vent. Vous achetez des titres que vous ne payez qu’à 1 % de leur valeur. Vous les revendez dans la foulée en faisant une grosse marge. Et vous empochez le bénéfice. Si le marché plonge, ce n’est pas grave. La banque éponge avec l’argent de ses clients. Quand vous êtes à la tête d’une banque, vous êtes souvent à la fois acheteur et vendeur. Ce casino géant est toujours gagnant pour vous banquier, puisque vous spéculez avec l’argent des autres.
Les banques sont de belles putes maquillées avec distinction.
Leurs propriétaires sont des types souriants qui vous regardent les mains dans les poches de leur joli costume gris. Ils sourient tous de la même manière, le bridge éclatant. Ils vous fixent de leur regard clair. Ils sont debout devant leur banque, comme les tenanciers des bordels d’Amsterdam ou d’ailleurs. Vous passez en matant la vitrine. Vous entrez, choisissez votre pute, grimpez un escalier, suivez un couloir. Puis vous vous dirigez vers une suite de chambres qui sont communes à toutes les filles. Les chambres sont l’outil de travail collectif. Elles sont gérées par une hôtelière qui paie le personnel pour changer les draps, donner les clés, surveiller le bon déroulement des opérations. L’argent encaissé est reversé à l’hôtelière qui le refile au propriétaire en se gardant une commission. Le système fonctionne.
Chaque banque a un nom différent, une vitrine distincte, mais, à l’étage du dessus, les employés qui bossent pour les banquiers se retrouvent derrière les mêmes écrans et se partagent le même marché. En bas, le banquier peut continuer à vous montrer ses dents en faisant son baratin. En haut, les employés turbinent pour le collectif. Les organismes de compensation financière sont l’outil de travail commun à toutes les banques de la planète. On les appelle aussi des chambres. Elles paient des informaticiens, des chargés de clientèle, des programmeurs pour veiller au bon déroulement des transactions. Que vous achetiez à crédit une voiture, une maison ou une semaine de détente en Sicile, la banque vend un produit qu’elle a trouvé chez un grossiste commun. Libres à elles de le vendre plus ou moins cher, de vous l’envelopper de rose ou pas. C’est un travail d’image et de communication. Un travail de gagneuse. Les banques vous aguichent puis vous baisent.
(Les banques, chap. 19)
(…)
Les vrais mafieux lisent le Financial Time ou le Wall Street Journal et descendent à l’Hôtel Royal de Luxembourg ou au Beau Rivage à Genève. Ils ne mangent pas de pâtes à Little Italy, mais plutôt dans un Milanese food de Londres où on sert des spaghettis aux truffes dans des coupes à champagne. Ils se sont civilisés, policés, politisés. Ils achètent des clubs de football avec des copains traders ou des actions du CAC 40 parce que c’est plus clean.
(…)
Rien n’est nouveau dans cette fabrication d’une mythologie simpliste. Nous sommes dans la société du spectacle parachevé. En 1967, Guy Debord expliquait déjà que la mafia et l’Etat était associée : La mafia n’est pas étrangère dans ce monde, elle y est parfaitement chez elle. Elle règne en modèle de toutes les entreprises commerciales avancées.
En mettant dans le même panier organisation mafieuse et société commerciale avancée, Debord fait référence à un temps où les entreprises commerciales n’étaient pas avancées, où des limites plus claires existaient entre mafia et Etat. L’avancement des sociétés tient à leur modernisme, à leur adaptation à l’époque. Le système mafieux reposant sur une organisation secrète et militaire et sur la terreur ne peut plus fonctionner pour une raison simple : son manque de rentabilité. Le mafieux a dû s’adapter et se civiliser pour survivre puis prospérer.
Les criminels ont un besoin vital de points aveugles sur la planisphère pour pratiquer leurs substitutions et phagocyter les systèmes démocratiques. Ils ont besoin de trous noirs et de processus discrets. D’endroit où ils savent qu’on ne viendra pas les emmerder. Même si un risque minimum existe toujours de les importuner. Je représente, par mon travail et certains de mes livres, une quantité infinitésimale de dérangement pour eux.
J’ai mis les pieds dans l’arrière-cuisine du village financier. J’ai compris le fonctionnement de ce bordel très policé. La multinationale à laquelle je me suis intéressé loue son savoir-faire, son impunité et ses coffres-forts à toutes les banques de la planète. Elle offre, moyennant commissions, quantité de services. Elle prête de l’argent, investit, archive, cautionne. Au besoin, s’arrange pour qu’il soit très difficile d’en retrouver la trace.
Nous avons localisé des lieux sur la planète, où la délinquance financière - ses ramifications, sa diversité, son implantation, sa nature protéiforme - est repérable. Des techniciens de la finance ont créé un outil complexe, subtil et performant, dont les règles de fonctionnement ne sont connues que des initiés. L’outil subtil des banquiers a permis la mondialisation financière. Il est un point aveugle de la finance mondiale. Une maison close où l’argent peut entrer, tranquillement, sans frapper. Et ressortir sans prévenir. Seuls quelques banquiers ont la clé. Pour entrer, il faut payer. L’abonnement est cher. On peut s’abonner directement, ou s’abonner chez un abonné, ou chez l’abonné d’un abonné d’un abonné. Ça marche en cascade. Chacun sa commission. Chacun ses fusibles.
Les chambres de compensations internationales sont les clés de voûte du capitalisme clandestin.
De manière générale, une clé de voûte est un élément unique qui permet de maintenir la cohésion des multiples éléments l’entourant.
Le capitalisme clandestin a pris le pas sur l’autre qu’on pourrait appeler le capitalisme officiel. Ou la vitrine légale. Le but ultime du capitalisme, l’officiel comme le clandestin, reste la fabrication de profit destiné à une minorité de privilégiés. Il nous enchaîne et nous plie à son service. Refuser sa logique devient de plus en plus difficile. Surtout quand on est journaliste ou écrivain. Dès que vous résistez, le système vous marginalise puis, si vous résistez vraiment, cherche à vous briser.
(in Mafia, chap. 48)
(…)
Certains banquiers sont comme les barons de Cosa nostra. Ils démarrent soldati, montent en grade. Capodecina, consigliere. Pour finir : capo dei capi. Ils agissent, mais ne parlent pas. L’omerta est la règle. La discipline dans les deux cas est militaire. Je ne parle pas des chefs d’agence ou des petits banquiers. Eux ce sont des soldats. Je parle de leurs généraux. Je parle des types à la tête des banques.
Le crime est à l’intérieur de nos sociétés. À l’intérieur des banques.
(in "le long repas de l’apocalypse", chap. 59)
Les photos viennent de la galerie W 44 rue Lepic Paris 18ième, où Denis
Robert expose entre le 6 et le 30 octobre.
Documents joints à cet article
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/les-vrais-mafieux-lisent-le-45136


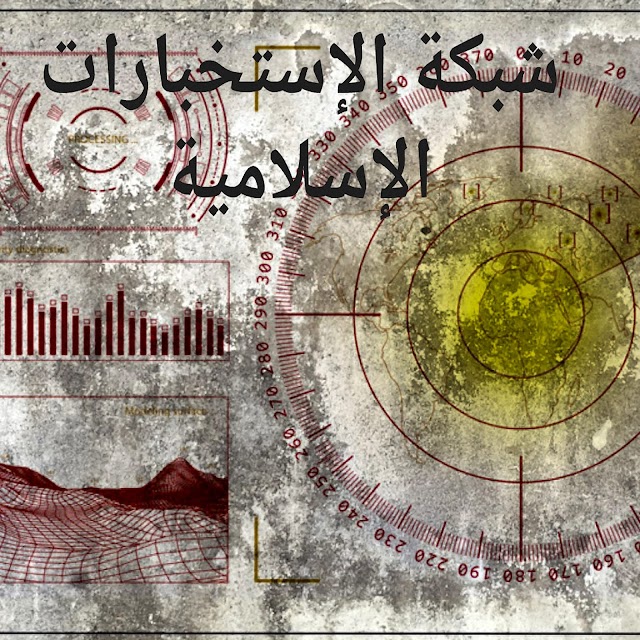


0 Comments